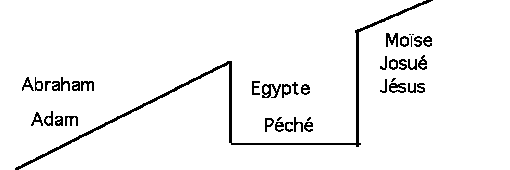|
Le salutIl y a quelques années, j'enregistrais une émission de télévision pour « Présence protestante ». En réponse à une question du journaliste qui m'interviewait, j'ai parlé du salut. Le réalisateur a immédiatement arrêté l'enregistrement et m'a dit: "vous venez d'employer un mot ecclésiastique qui ne dit absolument rien au grand public; il vous faut l'expliquer", ce que j'ai fait à la reprise de l'enregistrement. Cet incident m'a frappé. Le mot "salut" désigne ce qui a été l'une des préoccupations majeures de la culture occidentale pendant des siècles, ce qui l'a peut-être le plus intéressé et le plus passionné. Et voilà que ce mot n'éveille plus grand chose, qu'on ne sait même plus ce qu'il signifie. Dans les milieux chrétiens, on l'emploie machinalement sans beaucoup se demander ce qu'il veut exactement dire. Il s'agit de l'un de ces mots pieux au contenu vague et imprécis qu'on prononce pendant le culte. Comme le mot "amen", il a une valeur rituelle plus qu'il n'est porteur de sens. Chez les non chrétiens, il ne correspond plus à une inquiétude, à une aspiration, à une recherche ou une attente. Il évoque pour eux quelques spéculations sur ce qui suit la mort, mais pas quelque chose qui concerne leur existence. La notion de saut leur semble déconnectée d'avec ce qu'ils vivent, sans rapport avec leur expérience. Le mot de salut semble avoir perdu, pour beaucoup de nos contemporains, sa force expressive, son pouvoir de signifier quelque chose. Il joue, cependant, un rôle beaucoup trop important dans le Nouveau Testament et dans le christianisme pour qu'on puisse l'abandonner. Il faut donc tenter d'en retrouver le sens. C'est ce que je vais essayer de faire en quatre temps. Le premier portera sur la compréhension chrétienne du salut. Le deuxième examinera la question : "Le salut, pour qui?". Le troisième s'intitulera : "de quoi sommes-nous sauvés?". Et enfin, le quatrième se demandera : "quand a lieu le salut, à quel moment le situer ?". 1. La compréhension évangélique du salut1. Son importanceL'annonce et l'affirmation du salut jouent un rôle capital, essentiel, décisif dans le christianisme. Il ne s'agit pas d'un thème accessoire, mais d'un thème central qui commande tous les autres. Pour dire en quoi consiste l'évangile, l'apôtre Paul le qualifie de "puissance de salut"*. Croire que Jésus nous sauve, l'accepter comme sauveur, voilà ce qui fait de quelqu'un un chrétien, et toute le reste vient après, est subordonné. Les Réformateurs l'ont, en particulier, fortement souligné. Contre une théologie qui développait volontiers des spéculations sur l'être de Dieu, Luther, Zwingli et Calvin, ont affirmé que la sotériologie (la doctrine du salut) doit occuper toute la place dans la doctrine, l'enseignement, la prédication de l'Église. La Bible ne dit de Dieu, du Christ ou de l'être humain que ce qu'il nous est nécessaire de connaître pour le salut. Calvin ne cesse de répéter que lorsque les théologiens et les prédicateurs s'occupent d'autre chose, ils tombent dans des spéculations inutiles et condamnables, ils se laissent emporter par une curiosité frivole. La foi chrétienne ne se centre ni sur un savoir ou une gnose, ni sur une contemplation, ou une mystique. Elle a pour seul centre, pour unique objet le salut qu'opère Jésus et qu'annonce l'évangile. 2. La spécificité de la compréhension évangélique du salutAu propos que je viens de tenir, on pourrait objecter, avec raison, que cette insistance sur le salut n'est pas propre au christianisme. Elle se trouve ailleurs. Même si l'Occidental moderne ne la comprend plus, il s'agit d'une notion extrêmement répandue. Toutes les religions se présentent plus ou moins clairement comme des voies ou des systèmes de salut. C'est même ce qui les caractérise et les différencie des philosophies : les philosophes, ou les savants (jusqu'à une époque récente, on le les distingue pas) sont mus par la curiosité, par le désir de connaître; ils cherchent à répondre à la question : "que sont et comment sont les choses?". Le religieux est, au contraire mû par une insatisfaction : "les choses ne vont pas bien, elles ne sont pas ce qu'elles devraient être; comment pouvons nous nous en sortir, et accéder à une situation meilleure? " Il ne faut pas, bien sûr, séparer trop radicalement philosophes et religieux, car il existe des philosophies proprement religieuses, comme le stoïcisme ou comme celle de Spinoza, qui essaient, elles aussi, de répondre, par le moyen de réflexion non pas un désir de connaissance, mais à une recherche de salut. Toutefois, même s'il s'agit d'une préoccupation que l'on trouve ailleurs, la manière dont le Nouveau Testament comprend le salut présente une très grande originalité. Cette originalité, le docteur Albert Schweitzer, qui, je vous le rappelle est pasteur et théologien avant d'être médecin, philosophe et organiste, l'a très bien mise en lumière*. Il remarque que dans le monde des religions (et parfois au sein du christianisme), on rencontre deux grandes tendances. 1. Le première refuse et rejette le monde. Elle le juge vil, mauvais, opposé, contraire à Dieu. Elle y voit le domaine du charnel, du matériel, voire du diabolique. Elle le condamne totalement et préconise une évasion en un au-delà. Ainsi, dans le platonisme de l'Antiquité, dans le bouddhisme et le brahmanisme, souvent on demande au croyant de se détacher du sensible par une ascèse, par le moyen de disciplines diverses (la pratique de la méditation par exemple). Il s'agit de fuir le matériel et ses soucis, de renoncer à ses activités pour s'adonner à la contemplation, pour entrer dans le domaine du spirituel. 2. Nous avons une deuxième tendance qui voit dans le monde non pas l'ennemi et l'adversaire de Dieu, mais, au contraire, l'émanation de sa volonté, l'expression de son être. Elle pense que tout ce qui existe et arrive dans la nature ou dans l'histoire dépend de Dieu. Il décide des événements; il gouverne dans le moindre détail l'Univers. Tout y est donc conforme à la volonté divine. Le salut consiste donc, ici, à se soumettre, à accepter l'ordre cosmique, à se mettre en harmonie avec ce qui nous entoure. Cette tendance st forte dans les religions de la Chine (Confucius, Lao Tseu), dans le stoïcisme, ainsi que certains courants de l'Islam. Dans le premier cas, le salut consiste à se détacher du monde, à s'en évader par les divers moyens qu'offre la religion. Dans le second cas, le salut consiste à s'adapter et se plier au monde, à s'accorder avec lui. Or, comme le souligne Schweitzer, le message de l'évangile diffère radicalement de ces deux conceptions. Il récuse aussi bien l'une que l'autre. Le Nouveau Testament ne prêche ni l'évasion ni la soumission, mais il annonce que Dieu opère une transformation. Comme le proclame l'Apocalypse*, il rend toutes choses nouvelles. On peut représenter cela par le tableau suivant :
Se sauver, pour un chrétien, ne signifie ni se réfugier dans une autre sphère ni se résigner à ce qui se passe. Le salut qu'annonce l'évangile consiste en une transformation que Dieu opère. Tandis que les deux premières tendances religieuses s'enferment dans une logique statique, l'évangile insère la notion de salut dans une dynamique du changement personnel, social, cosmique. Cette dynamique correspond à la conception biblique qui voit dans le temps un vecteur orienté, une ligne droite qui a un sens; l'histoire avance, se dirige vers le Royaume; alors qu'ailleurs, on se représente le temps comme un cercle où l'on tourne en rond; il faut ou l'accepter ou en partir, mais le temps n'amène rien. Dans le christianisme, l'histoire a une très grande importance. Je signale, entre parenthèses, qu'il faut comprendre à la lumière de cette analyse le fameux principe du "respect de la vie" défendu par Albert Schweitzer. Les tendances religieuses de la première catégorie, celles qui condamnent le monde, méprisent la vie qu'elles considèrent comme un malheur et une déchéance. Les tendances religieuses de la deuxième catégorie, celles qui croient que le monde se conforme à la volonté de Dieu, acceptent et sanctifient la souffrance, la mort, les forces négatives et destructrices qui agissent dans le monde. Au contraire, l'attitude chrétienne conduit à un véritable respect de la vie. Le monde et l'être humain sont aimés et sauvés; on ne doit donc pas les rejeter; mais ils sont aimés et sauvés pour devenir autres. Nous n'avons donc pas à consentir à la part de mal et de mort qui s'y trouve. L'originalité de la conception évangélique du salut (que le christianisme n'a pas toujours bine compris) vient de ce qu'elle ne préconise ni la fuite hors du monde, ni la soumission à ce qui est, mais qu'elle annonce une transformation de toutes choses et de tout être. 3. Délivrance et accomplissementQuand on essaie d'analyser la notion de salut, telle que la présente le Nouveau Testament, on constate qu'elle combine et conjoint deux idées différentes : celle de la délivrance et celle de l'accomplissement. 1. En premier lieu, le salut se vit comme une libération et une guérison. Sauver quelqu'un veut dire le mettre hors de danger, le débarrasser du mal qui le menaçait ou le faisait souffrir, le tirer d'une situation de détresse. Ainsi, dans l'Ancien Testament, la sortie d'Égypte fournit le modèle à partir duquel on pense le salut. Les hébreux subissaient une situation d'esclavage et de misère extrême. Dieu envoie un libérateur, Moïse, qui les tire des mains de leurs oppresseurs. Dans cette histoire, on a vu une image, une figure de l'aventure humaine. Depuis la faute d'Adam, les forces du mal oppriment écrasent l'être humain. Dieu leur envoie son fils Jésus Christ, et la résurrection, la pâque chrétienne, correspond à la sortie d'Égypte la pâque juive. Le tableau suivant montre le parallèle :
La délivrance prend aussi la forme d'une guérison, et les récits de guérison, qui abondent dans les évangiles, mais existent aussi dans l'Ancien Testament, offrent un modèle tout à fait proche de celui de la libération pour penser le salut. Étymologiquement, salut dérive du mot latin salvus qui veut dire "guéri", "saint", "en bonne santé". Le péché de l'être humain peut se comparer à une maladie et Jésus à un médecin ou à thaumaturge qui vient en guérir. La faute d'Adam a fait des êtres humains des esclaves, et des malades. Le Christ vient pour réparer cette faute et en annuler les conséquences, ce qu'explique au onzième siècle Anselme de Cantorbéry, dans un traité célèbre le Cur Deus homo? Dans cette perspective, si Adam n'avait pas péché, le Christ ne serait pas venu; l'être humain n'aurait en effet pas eu besoin de sauveur. Seul un esclave ou un prisonnier peut être délivré, seul un malade a besoin de guérison. Comme Jésus le dit lui-même : "ce ne pas sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades"*. 2. À ce premier thème de la délivrance et de la guérison, s'en ajoute un second, celui de l'accomplissement ou de l'épanouissement, qui va introduire une perspective différente. Le salut apporte une sorte de plénitude; il nous fait parvenir à un état où il n'y a rien à désirer, où aucun manque, aucune insatisfaction ne nous affecte. Quand on insiste sur ce second aspect du salut, on estime que l'exode, la sortie d'Égypte représente seulement le début du salut. Il ne sera achevé qu'avec l'entrée dans la terre promise et l'installation des hébreux en Palestine. Les israélites y vivront en harmonie avec Dieu et y connaîtront une sorte de perfection grâce à la loi, à l'alliance qui assure une relation juste et constante avec Dieu. La captivité d'Égypte représente dans l'histoire un accident, une parenthèse malheureuse que vient fermer l'exode. L'entreprise commencée par les patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, après une interruption, va se poursuivre avec Josué. En sortant d'Égypte, les hébreux renouent le fil, un moment cassé, de leur histoire.
De même, Adam, avant la chute se trouvait au commencement d'une histoire. Dans l'Éden, il n'était nullement un homme parfait, accompli, mais un "être animal", comme le dit Paul*; il devait croître, se développer et se transformer en être spirituel. On peut le comparer à un enfant qui doit grandir pour atteindre la stature adulte. Le péché contrecarre son développement, comme une maladie peut arrêter la croissance d'un enfant. La maladie une fois guérie, le péché pardonné, la croissance et le développement reprennent. Dans cette perspective, le Christ serait venu même si Adam n'avait pas péché, comme l'ont soutenu Irénée, Duns Scot, et Thomas d'Aquin. En effet, l'œuvre et la mission du Christ ne se bornent pas à délivrer de l'esclavage, à guérir la maladie, à pardonner le péché. Elles consistent essentiellement à aider les êtres humains à progresser vers le Royaume ; même s'ils n'avaient pas péché ils auraient eu besoin de cette aide. Le salut ne se borne pas à effacer le péché; il ne faut pas restreindre, limiter l'évangile à l'annonce du pardon. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus vaste : Dieu avait un grand projet pour Adam. Même sans sa faute, Adam aurait eu besoin d'un salut qui l'aurait conduit à se développer pour atteindre la plénitude à laquelle Dieu le destinait. Cette différence de vue ou d'opinion entre ces deux courants peut paraître, à première vue, assez théorique. En fait, elle a des conséquences pratiques sur la prédication et l'enseignement de l'Église. Dans le premier cas, on centrera tout sur l'appel à la repentance et l'annonce du pardon des péchés. Dans le second cas, on se préoccupera aussi de l'éducation et du développement des êtres humains, de ce qui favorise leur épanouissement. On proclamera le pardon certes, mais aussi on travaillera à la construction de la personne et de la cité humaine : en s'occupant de formation, en créant des hôpitaux, en luttant pour des conditions de vie non aliénantes, les chrétiens s'inscrivent dans la dynamique du salut tout autant que lorsqu'ils annoncent le pardon des péchés. Ces deux thématiques entraînent deux conceptions différentes de la mission chrétienne. 2. Le salut pour qui?Cette question a donné lieu à de grandes controverses dans le christianisme. Je présente brièvement les thèses ou les positions antagonistes. 1. L'extension du salutEn ce qui concerne l'extension du salut, depuis toujours, probablement déjà à l'époque du Nouveau Testament, les chrétiens se divisent en deux tendances : une tendance particulariste et exclusiviste pour qui le salut ne touche qu'une partie de l'humanité, et ne concerne qu'un secteur limité de la création; une tendance universaliste ou inclusiviste pour qui le salut englobe l'ensemble de ce qui est, et atteint la totalité du monde. Cette divergence entre particularistes et universalistes prend deux formes. 1. D'abord, elle oppose une conception personnaliste et une conception cosmique du salut. Selon la conception personnaliste, le salut concerne seulement l'être humain. La bonne nouvelle de l'évangile s'adresse à lui. Le Christ est venu pour lui, non pour les animaux ni pour la matière inanimée. Certains vont même plus loin, et estiment que seule une partie de l'être humain est sauvée, le corps étant destinée à redevenir poussière. On comprend donc le salut comme l'accès de l'âme auprès de Dieu après la mort de l'être humain. La conception cosmique voit, au contraire, dans le salut un grand renouvellement de toutes choses. Il concerne donc la matière inanimée, les végétaux, les animaux, aussi bien que les humains. La Bible semble aller plutôt dans ce second sens. Elle souligne la solidarité qui existe entre l'être humain et la nature. La faute d'Adam a des conséquences pour la création entière qui, comme le souligne Paul*, soupire après une délivrance. L'Apocalypse parle de nouveaux ceux et d'une nouvelle terre : ces textes suggèrent donc un salut qui s'étend à l'univers entier. 2. L'opposition entre particularistes et universalistes porte en second lieu sur les êtres humains. Le Nouveau Testament nous dit que ceux qui croient en Jésus sont sauvés. Qu'advient-il des autres? Y a-t-il pour eux une possibilité de salut ou sont-ils destinés à la perdition, que l'on peut comprendre soit comme un châtiment (l'enfer), soit comme un anéantissement (la mort éternelle)? On rencontre dans le christianisme trois positions sur ce point : D'abord, on trouve une position dure, selon laquelle seuls ceux qui confessent ouvertement, invoquent explicitement et servent consciemment et volontairement Jésus Christ sont sauvés. Tous les autres quels que soient par ailleurs leurs qualités ou leurs mérites, seront perdus. Par exemple, les jansénistes pensaient que le salut ne concerne qu'un tout petit groupe d'élus. On a beaucoup parlé d'une statue de Port-Royal qui représentait un Christ aux bras fermés, ou à peine entrouverts; il n'accueille que quelques rares fidèles. Un des théologiens de Port-Royal, Nicole, que l'on interrogeait sur le sort des américains (c'est à dire les amérindiens) avant la découverte de Christophe Colomb et l'arrivée des missionnaires, répondait : "pas un ne sera sauvé". Cette attitude étroite se trouve dans quantité de sectes où on destine allègrement à l'enfer la majeure partie de l'humanité. Thomas d'Aquin disait que la souffrance des réprouvés augmentait la joie des sauvés. On a parfois l'impression que pour certains chrétiens, le salut ne serait pas un vrai et joyeux salut, s'il n'y avait pas un grand nombre de damnés (Augustin parle de la "masse de perdition" ou de la masse des damnés). 2. On rencontre, ensuite, une position intermédiaire, nuancée qui essaie de distinguer diverses situations et de tenir compte des différences. On dira, par exemple, que ceux qui n'ont pas connu le Christ parce qu'on ne leur en a jamais parlé (les amérindiens, ou les africains avant la venue des missionnaires) ont droit à l'indulgence divine; ou bien encore que Dieu pardonne aux païens vertueux, à ceux qui se sont bien conduits moralement (ainsi Zwingli, dans un texte qui suscita une violente réaction de Luther, affirme que Hercule, Socrate, Caton font partie des sauvés). Par contre, pour ceux qui ont commis des crimes, ou qui ont mal vécu, ainsi que pour ceux qui ont entendu la prédication de l'évangile et ne se sont pas convertis, il n'y a aucun salut à espérer. 3. Il existe, enfin, en troisième lieu, une position large qui estime que Dieu n'aura atteint son but que lorsque tous les êtres humains auront été sauvés. Aucun n'est exclu de son œuvre salvatrice et elle ne prendra fin que lorsqu'elle aura atteint tout le monde. Selon une phrase de Paul, "comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ"* Ceux qui n'ont pas été convaincus par l'évangile durant leur vie, le seront après leur mort (la première épître de Pierre parle d'une évangélisation des morts*). L'œuvre salvatrice de Jésus se poursuit d'une manière ou d'une autre jusqu'à ce qu'elle s'étende à toute l'humanité. À la fin de sa vie, Karl Barth a adopté cette position. Il estimait que l'enfer, les peines éternelles et l'anéantissement de certains êtres humains signifieraient pour Dieu un échec, car le péché aurait réussi à faire avorter en partie son entreprise de salut, l'aurait empêché de la conduire à son terme. De manière analogue, Tillich estime que le salut d'un être humain implique le salut de son monde, de ceux qui l'entourent, de ceux avec qui il a des relations, car ces autres font partie de lui. Le salut d'un seul entraîne donc comme conséquence le salut de tous. 2. Le salut gratuitCette question a joué un rôle central au moment de la Réforme. Le Nouveau Testament souligne très fortement et à plusieurs reprises la gratuité du salut. "Cela ne vient pas de vous, écrit Paul*, c'est le don de Dieu". Le salut représente un cadeau que Dieu nous fait sans que nous l'ayons mérité, sans nous soumettre à des épreuves préalables, sans nous imposer de conditions pour l'obtenir, sans rien nous demander en échange. Il y a quelque chose de tellement extraordinaire dans cette affirmation qu'on a toujours eu beaucoup de peine à la comprendre et à l'accepter. Tout au long de l'histoire chrétienne a resurgi la question des mérites. On a toujours cherché à faire dépendre le salut, en partie ou en totalité, des actes et des comportements de chacun. Sur ce point comme sur le précédent, on peut distinguer trois positions. 1. La première déclare que l'être humain doit gagner son salut. Il l'obtient par son obéissance aux commandements de Dieu, par la mise en application du décalogue et du sermon sur la montagne, par ses vertus et ses qualités. Le Christ lui montre la voie qu'il doit suivre, lui indique ce qu'il faut faire, lui dit comment vivre. Il trace en quelque sorte un programme. L'accomplissement de ce programme rend l'être humain digne d'entrer dans le Royaume. On appelle cette position le pélagianisme, parce qu'elle a été soutenue au quatrième siècle par le moine Pelage, contre lequel a réagi Augustin. Les Églises catholique et protestante l'ont sévèrement condamnée, parce qu'elle contredisait l'affirmation néotestamentaire de la gratuité du salut. Mais elle a toujours eu des partisans. En fait ici ce n'est pas Dieu qui sauve, mais l'être humain qui se sauve lui-même, par ce qu'il fait, par ses œuvres. 2. On qualifie en général, la seconde position, de synergisme ou de semi-pélagianisme. Synergisme est composé des mots grecs sun "avec" et d ergon "travail"; il désigne un travail fait en commun, à plusieurs. Pour cette seconde position, le salut résulte d'une collaboration entre Dieu et nous, chacun faisant une partie du travail. L'homme fait un effort, mais qui reste toujours insuffisant; il y a toujours en lui des ratés, des défaillances. Toutefois, Dieu tient compte de ses efforts et les récompense en lui donnant ce qui lui manque, en effaçant ses échecs. L'être humain ne peut pas se sauver tout seul, il n'a pas assez de force pour cela. Mais s'il fait preuve de suffisamment de bonne volonté, Dieu ferme les yeux sur ses échecs, sur ses fautes, et le sort d'affaire. La sagesse populaire a exprimé cette idée dans un proverbe que reprend une fable de La Fontaine :"aide-toi, le ciel t'aidera". Le catholicisme classique, et en particulier au seizième siècle le Concile de Trente, qui s'oppose à la Réforme, défend cette seconde position. 3. La troisième position caractérise le protestantisme, aussi bien luthérien que réformé, mais se rencontre également dans certains courants du catholicisme, comme le jansénisme. Elle attribue le salut à la seule action de Dieu. Il décide de nous faire grâce, alors que nous ne l'avons pas mérité, sans que nous ayons des circonstances atténuantes pour nos désobéissances et notre péché. Il nous accepte, bien que nous soyons inacceptables. Dieu fait tout le travail. Le salut, dit Luther, est l'œuvre de Dieu en nous; les autres œuvres, il les accomplit avec nous et par notre moyen; celle là il l'accomplit "en nous et sans nous". Pour faire comprendre la différence entre la seconde et la troisième position, je me servirai d'une image que j'ai emprunté à un ami hindou. Quand un bébé singe se trouve en danger, quand quelque chose le menace, sa mère court à lui et le petit s'accroche, s'agrippe à ses épaules. Pendant que sa mère l'emporte, il se tient, et il lui faut se tenir solidement. Il ne peut pas se tirer d'affaire tout seul; il a besoin de sa mère; mais il doit aussi participer. S'il lâche prise, il sera perdu. Nous avons là une image du salut d'après le catholicisme classique. Par contre, quand un chaton court un risque, quand un péril le guette, la mère chatte se précipite, le prend par la peau du cou, l'emporte dans un lieu sûr, et le met hors de danger sans qu'il coopère. Il reste passif, il lui arrive même de se débattre. Sa mère fait tout le travail. Nous avons là une parabole du salut tel que le comprend le protestantisme classique. On a souvent dit que la conception catholique était plus mobilisatrice, qu'elle incitait plus aux bonnes actions que la conception protestante. En fait, on constate que les protestants ont autant, sinon plus agi que les catholiques. La différence ne se situe pas dans l'engagement, aussi vif dans un cas que dans l'autre; elle réside dans les motivations qui changent. Le catholique classique agit pour obtenir le salut, afin de gagner la grâce de Dieu. Le protestant agit parce que Dieu lui a fait grâce, par reconnaissance et amour envers celui qui l'a sauvé. Je me sers à nouveau d'une image pour faire saisir la différence : on peut offrir un beau cadeau à quelqu'un en vue d'obtenir sa bienveillance (ainsi le catholique offre ses bonnes œuvres à Dieu); on peut offrir un beau cadeau à quelqu'un afin de le remercier de ce qu'il a fait pour nous (le protestant comprend ainsi les bonnes œuvres qu'il accomplit). 3. De quoi sommes nous sauvés?J'introduis cette troisième partie par une petite histoire assez cruelle pour les théologiens. Un savant professeur de théologie se promène, absorbé par ses réflexions et ses méditations. Il doit faire un cours sur le salut qui le préoccupe ; il y pense, il réfléchit à cette notion, à son sens, à la manière dont il va la présenter aux étudiants. Il longe un fleuve et, comme il passe sur un pont, un cri l'arrache à ses pensées. Un homme tombé à l'eau, emporté par le courant se débat et crie: "sauvez-moi, sauvez-moi". Le théologien s'arrête, tout perplexe, et répond : "oui, bien sûr, mais qu'entendez-vous exactement par sauver?" Deux raisons rendent cette réponse ridicule : d'abord, son inadaptation, elle appelle à une réflexion au moment où il faut agir d'urgence; ensuite son inutilité : la situation de cet homme rend parfaitement clair son appel. Autre histoire, qui vient des États-Unis. Dans une petite ville de l'Indiana, les différentes églises, méthodistes, baptiste, épiscopalienne, presbytérienne, pentecôtiste etc. se sont mises d'accord (ce qui est déjà un très grand miracle) pour entreprendre en commun une campagne d'évangélisation sur le thème : "Jésus notre sauveur". Cette campagne commence par un immense défilé des chorales, des orchestres, des groupes de jeunes, des majorettes des diverses églises, qui portent tous d'immense pancarte : "Jésus sauve". Le lendemain, le journal local publie une grande photographie de ce défilé avec un commentaire, ironique : "ils nous disent tous qu'il sauve, mais personne ne dit de quoi". De ces deux histoires, je tire la conclusion, qui me paraît évidente, que pour comprendre ce que signifie le salut, il importe de préciser de quoi nous sommes sauvés. Si on ne le fait pas, l'affirmation "Jésus sauve" devient un slogan vide, sans contenu, semblable aux spots publicitaires dépourvus de sens. Qu'est ce qui donc pèse sur l'être humain et demande que l'on vienne à son secours ? De quoi avons-nous besoin d'être guéris ou délivrés? À cette question on a donné, dans l'histoire du christianisme, quatre réponses différentes. Autrement dit, on a discerné quatre formes principales sous lesquelles se manifeste la détresse humaine. 1. La culpabilitéJe mentionne, en premier lieu, la forme la plus classique, celle à laquelle on pense tout d'abord, à savoir la culpabilité. L'être humain se sent fautif, impur, indigne. Il manque d'innocence, il a toujours quelque chose à se reprocher, ce qui l'inquiète et le travaille. Ici, on présentera le salut avant tout comme le pardon des fautes, et on mettra l'accent sur les textes bibliques qui affirment que Jésus sauve du péché et de ses conséquences. À certaines époques de l'histoire, le sentiment de culpabilité a été très vif. À la fin du Moyen Age, la conscience de leurs fautes et la peur du châtiment terrorisaient beaucoup de gens. Le jugement dernier et l'enfer représentaient pour eux une hantise qu'ils ont exprimée dans d'admirables et hallucinants œuvres d’art picturales, musicales, littéraires. Les meilleurs s'imposaient une vie d'austérité et de renoncements; ils multipliaient les actions charitables et les pratiques pieuses en espérant qu'elles leur vaudraient l'indulgence divine. Mais ils n'étaient jamais sûrs d'en avoir assez fait et ils craignaient la condamnation. Face à cette angoisse, la Réforme a proclamé que selon l'évangile, le salut était un don de Dieu et non la récompense des œuvres humaines. L'évangile annonce que Dieu ne tient pas compte de nos fautes et que nous n'avons rien à craindre. Ce message a représenté au seizième siècle une véritable libération pour beaucoup. Il a eu un impact considérable et a bouleversé l'Europe. Il touche moins, semble-t-il, les modernes qui n'ont pas au même degré le sentiment de leur culpabilité; ils se sentent souvent plus victimes que responsables. Il ne s'ensuit nullement que cette première conception de la détresse humains soit dépassée et inutile. L'éliminer de la prédication serait une erreur. Mais il faut avoir conscience qu'elle correspond moins à notre sensibilité qu'elle ne le faisait autrefois, et que la question ou l'angoisse à laquelle elle répond n'a pas la même force qu'il y a quatre siècles. 2. La mortLa détresse humaine prend une seconde forme, la peur de la mort, la crainte de la disparition de notre être. L'être humain a conscience du caractère fragile, éphémère de sa propre existence. Il se sait très vulnérable; à tout moment, une maladie ou un accident peut l'emporter. Il n'est jamais à l'abri. De plus, aujourd'hui, nous savons que l'humanité dans son ensemble se trouve menacée par l'épuisement des ressources naturelles de la terre, par l'accroissement de la pollution, par les maladies et les épidémies qui tiennent à de mauvaises conditions de vie. Et puis, il y a aussi le péril atomique dont Tchernobyl est devenu le tragique symbole. Nos activités pacifiques se révèlent aussi dangereuses que les militaires et la mort totale se profile à l'horizon. Elle opère déjà dramatiquement et sinistrement dans de nombreux pays. De cette présence constante de la mort, résulte une angoisse et une révolte, qu'exprime bien la célèbre statue de Richier, à Bar-le-Duc, ce squelette qui tend son bras, le cœur saignant dans la main, vers le ciel. Devant la détresse que suscite la menace constante de la mort, le salut consiste dans le don de la vie éternelle, dans la proclamation de la résurrection. L'évangile nous affirme que nous ne sommes pas destinés au néant, qu'un avenir nous est promis et ouvert. Le message pascal de la victoire du Christ sur la mort retentit comme un espoir et un appel à lutter contre les puissances destructrices. Devant cette forme de détresse, on mettra au centre de la prédication du salut, non pas le crucifié portant nos péchés, comme dans le cas précédent, mais le Ressuscité, le Christus victor sorti de la tombe. 3. L'absurdeLe non-sens ou l'absurde représente une troisième forme de la détresse humaine. Nous rencontrons ici un des problèmes majeurs du vingtième siècle, que l'art, la littérature, la philosophie ont souligné. Les romans de Kafka l'expriment admirablement. Les existentialistes, Sartre, Camus, Bataille ont fortement mis en valeur à la fin de la seconde guerre mondiale. Des auteurs aussi dissemblables que Cioran ou Woody Allen le traduisent également. L'être humain manque de sens. Il ne sait pas, il ne comprend pas pourquoi il vit. Il a l'impression de se trouver dans monde déboussolé, qui l'oblige à mener une existence de fou. L'effondrement des structures et valeurs traditionnelles renforce ce sentiment; la famille se disloque, le travail manque (et du coup, le chômeur ne sait plus à quoi sert sa vie); souvent, celui qui a un métier l'exerce dans des conditions déraisonnables et stupides; les valeurs morales s'effondrent. On n'a rien à quoi se raccrocher, personne ne nous indique une route sûre. Dans les pays d'Occident, on n'a jamais disposé d'autant de richesses et de moyens; et jamais la vie n'a paru aussi plate, aussi bête, aussi insatisfaisante. D'où la révolte de certains, la résignation des autres, et l'appétit de divertissements de ceux qui cherchent à s'étourdir. À cette situation, répond le thème évangélique de la lumière, qui dissipe l'obscurité. Jésus nous sauve en nous éclairant, en donnant une direction et une orientation à notre vie, en nous ouvrant un chemin. Au centre de la prédication du salut confrontée à cette situation, peut-être faut-il placer le Saint Esprit qui nous rend sensibles à une présence en laquelle se trouve le sens dernier de toute vie et de toutes choses. Ce n'est pas par hasard si le thème de l'Esprit a pris depuis trente ans une telle importance (alors que dans les cas précédents on insistait plus sur le Christ). 4. La libérationJe signale une quatrième forme de l'expérience humaine de la détresse : l'aliénation socio-économique. L'être humain se découvre pris dans un système de production, de consommation, d'organisation du monde qui l'assujettit, le domine, lui enlève la maîtrise de son existence, qui souvent le condamne à la misère ou à une vie dépourvue d'intérêt et de liberté. Tout se centre sur l'objet à fabriquer, à vendre ou à acheter, et on lui subordonne le sujet. Il devient la victime d'une logique économique folle qui produit de plus en plus, en faisant travailler de moins en moins de gens, qui multiplie les chômeurs et les miséreux au fur et à mesure qu'elle accumule des richesses. Il ne peut que se soumettre; on ne lui donne aucune chance de vivre autrement. Il a le sentiment qu'on l'exploite, qu'on le vole, qu'on le réduit à une sorte de servitude. Il se sent dépouillé de sa qualité d'être humain; on le traite comme une "non-personne", selon une expression beaucoup utilisée par les théologiens sud-américains. De millions de gens vivent dans une condition inhumaine, c'est à dire où on ne tient pas compte de leur humanité, ou on la nie. À cette conscience d'un esclavage politique, social, économique, particulièrement vive en Amérique latine, ont répondu les théologies de la libération avec beaucoup de courage et quelques excès. Elles s'appuient beaucoup sur l'Ancien Testament, sur le thème de la sortie d'Égypte du peuple d'Israël ou sur l'appel des prophètes à une société plus juste. Pour elles, le salut consiste d'abord dans la destruction des esclavages économiques. Elles voient dans l'évangile une puissance capable de renverser la société et de transformer le monde. La prédication doit avoir une dimension politique, si on veut qu'elle ait un sens et qu'elle apporte aux démunis, aux exploités un véritable message de salut. ConclusionJe termine cette analyse par quatre remarques 1. J'ai mentionné quatre des formes de la détresse humaine, celles qui à tort ou à raison me semblent être les plus importantes et avoir joué un rôle prédominant dans l'histoire de l'humanité. Je ne prétends pas en avoir dressé une liste complète, et on pourrait en citer d'autres. Par exemple, la détresse de la solitude, à quoi répondraient l'affirmation du Dieu Emmanuel (avec nous) et le thème de Jésus notre ami (qui a connu un grand succès au début de notre siècle). On pourrait s'interroger aussi sur la vogue que connaissent les psychothérapies; elles témoignent sans doute d'un besoin qu'ont les gens de parler, de s'exprimer, de se raconter, donc de sortir de leur solitude. Mais elles révèlent aussi une détresse qui se manifeste comme malaise de la conscience; peut-être faut-il simplement y voir un avatar du sentiment de culpabilité, mais plus profondément de ce qu'on a appelé le mal être, le "se sentir mal dans sa peau". Drewermann y a beaucoup réfléchi, et pour lui, aujourd'hui, le salut prend la forme de l'équilibre ou de la santé psychologiques. 2. Il me paraît important de prendre acte de la pluralité des expériences de la détresse et, par conséquent, des compréhensions du salut. N'essayons pas trop vite de les ramener à l'unité. On se tromperait gravement en voulant tout soumettre à un moule unique, en cherchant à imposer à tous les croyants la même démarche spirituelle et théologique, en exigeant, par exemple, que tout le monde passe par le sentiment de culpabilité tel que le seizième siècle l'a éprouvé. L'Église Réformée de France insiste beaucoup depuis quelques années sur la pluralité, et je crois qu'elle a raison : il ne faut pas étouffer la diversité des doctrines, ni celle des cheminements spirituels. S'il ne faut pas réduire cette variété, il importe cependant de voir qu'il existe une unité profonde entre ces diverses expériences. Sous des formes différentes, il nous est dit toujours la même chose, que j'exprime de manière un peu abstraite : que la puissance divine, qui opère en Christ surmonte les négativités avec lesquelles nous sommes aux prises, qu'elles soient d'ordre moral (la faute), physique (la mort), spirituel (l'absurde) ou social (l'aliénation économique et politique). Le salut ne se cantonne pas à un domaine de notre existence, il opère dans tous. Je représenterai à la fois la diversité et l'unité par le schéma suivant.
3. Nos explications et nos schémas répondent à une nécessité. Nous en avons besoin pour comprendre et faire comprendre. Il n'en demeure pas moins qu'ils appauvrissent et mutilent l'évangile, ignorent ou écartent certaines de ses dimensions. Aucun des cheminements que j'ai indiqués ne suffit, ni a une valeur absolue; chacun présente des avantages et comporte des risques de déviation. D'où l'utilité d'avoir plusieurs schémas; non pas parce qu'en les additionnant on arriverait à une expression suffisante de l'évangile, mais parce que cette pluralité entraîne une sorte de critique mutuelle, et oblige à relativiser celui qui a notre préférence. Elle nous empêche de confondre l'évangile avec l'expression que nous lui donnons. Elle me paraît le meilleur garde-fou contre l'idolâtrie qui ne distingue pas Dieu, son action, son salut de l'idée que nous en avons, de la manière dont nous les comprenons. Quand au nom d'une conception traditionaliste centrée sur le péché, on a voulu disqualifier les théologies de la libération, on a eu tort. Mais quand les théologies de la libération, on voulu éliminer la faute individuelle pour ne parler que de la misère sociale, elles perdent aussi une dimension de l'évangile. 4. Je viens de dire que l'évangile contre ce qui menace notre être et qui risque de le désagréger sur le plan physique, moral et spirituel nous annonce que le pardon, la vie, le sens, la liberté ne nous manqueront pas. Il donne ainsi une réponse aux questions les plus profondes de l'être humain. Toutefois, cette réponse n'est pas celle de la facilité. Ni la faute, ni la mort, ni le doute, ni l'aliénation sociale ne nous sont épargnées. Tout cela ne disparaît pas par enchantement. La foi ne supprime pas les problèmes et les difficultés; elle donne le courage de les affronter, de ne pas renoncer, de continuer à lutter. Nous vivons le début, le commencement du salut. Dans une belle prédication de Noël, Tillich le compare au bébé de la crèche; il doit grandir, se développer, il nous oriente vers un avenir. Le salut est à la fois ce qui nous donne la force d'avancer et ce vers quoi nous nous avançons. Il n'est pas un état, mais un combat et un dynamisme. 4. Quand a lieu le salut ?À cette question, on a donné trois réponses. Pour la première, le salut représente l'avenir de la vie croyante ou de la foi vécue, pour la seconde il représente son présent, et pour la troisième son passé. 1. Le salut, avenir de la foi.La première réponse se trouve dans le catholicisme classique (celui du Concile de Trente). Quand on consulte les textes, on constate très vite qu'il n'a jamais enseigné le salut par les œuvres. De même que la Réforme, il affirme que Dieu seul sauve, et qu'il le fait par grâce. Le concile de Trente déclare très nettement : "si quelqu'un dit que l'homme peut être justifié devant Dieu par ses œuvres. … sans la grâce divine qui vient par Jésus Christ, qu'il soit anathème"*. Où se situe donc le désaccord? Il porte sur la manière de comprendre la grâce et son action. Selon la Réforme, elle consiste en un acte de Dieu qui, de manière souveraine et forensique (c'est à dire extra nos, du dehors) change notre relation avec lui, tandis que le catholicisme du seizième siècle y voit plutôt une force ou une puissance surnaturelles que Dieu met à notre disposition afin de nous aider à avancer sur le chemin qui conduit au salut. En 1530, à la Diète d'Augsbourg, pour répondre à la confession luthérienne rédigée par Mélanchthon, quelques théologiens, dont le plus connu est Jean Eck, rédigent une Confutatio où on lit que "Dieu nous donne une grâce initiale qui nous rend capable d'acquérir des mérites en vue de notre salut"*. Dix-sept ans plus tard, le Concile de Trente déclare que Dieu donne au départ sa grâce aux pécheurs "sans aucun mérite préalable en eux", mais qu'ensuite, ils doivent "acquiescer et coopérer librement à cette grâce ... L'homme n'est nullement inactif ... il pourrait ... la rejeter, et pourtant sans la grâce divine, il demeure incapable de se porter ... vers cet état de justice devant Dieu"*. On pourrait comparer le croyant à un lilliputien qui aurait à gravir un gigantesque escalier aux marches beaucoup trop hautes pour lui. La grâce le hisse en haut de la première marche; il doit aller ensuite vers la marche suivante. S'il fait cet effort, il recevra une nouvelle grâce qui lui permettra d'accéder au niveau supérieur, et ainsi de suite jusqu'au bout. Sans la grâce, nous ne pourrions rien faire, et nous la recevons toujours comme un don gratuit et immérité*. Néanmoins, il dépend de nous qu'elle ne soit pas stérile et vaine. La grâce met en route une progression qui aboutit au salut. Le salut se situe donc bien dans l'avenir, au terme du chemin; il vient récompenser et couronner une vie chrétienne qui a su utiliser la grâce imméritée qui lui a été accordée. Alors que la Réforme voit dans la foi le salut opérant irrésistiblement en nous, le Concile de Trente la considère comme "le commencement du salut"*. Dans cette perspective, le salut est le but suprême, la finalité dernière, la réalité eschatologique qui se suffit à elle-même et ne conduit à rien d'autre. 2. Le salut, présent de la foi.Pour la seconde attitude, qui se rencontre plutôt dans le luthéranisme et les théologies existentialistes contemporaines, le salut se situe non pas dans l'avenir, mais dans le présent de la foi, dans l'instant qu'elle vit. Il m'arrive comme un événement surprenant. Alors que Dieu devrait normalement me rejeter et me condamner parce que mon péché me coupe totalement de lui, voilà qu'il décide, par le Christ, de ne pas tenir compte de ma faute, de me pardonner, de ne pas tenir compte de ma culpabilité et de mon indignité. La célèbre formule simul justus simul peccator (à la fois, en même temps juste et pécheur) exprime bien le paradoxe de la grâce : le pécheur se trouve dans la condition d'un juste; le croyant se sait à la fois inacceptable à cause de ce qu'il est, et cependant accepté par Dieu. Le croyant justifié reste pécheur. Son péché ne s'évanouit pas. L'acte de Dieu qui décide de ne pas en tenir compte se renouvelle donc à chaque instant. Nous ne cessons pas d'être inacceptables, et Dieu ne cesse pas de nous accepter malgré ce que nous sommes. Mon salut se passe toujours aujourd'hui, dans le moment que je suis en train de vivre, dans mon présent. La parole qui me fait grâce ne se trouve jamais derrière moi, dans mon passé. Elle constitue un événement qui ne se transforme pas en possession. Il n'y a pas un "après" ou une suite du salut*. On ne devient pas un sauvé, comme un jour on devient un bachelier ou un retraité, mais Dieu nous sauve sans cesse à nouveau. De manière caractéristique et frappante, pour Bultmann, très luthérien sur ce point, peut-être plus luthérien que Luther lui-même, dans l'événement de la foi le moment fondateur de la création, l'acte décisif de la croix et l'intervention eschatologique finale deviennent présents. Ils n'appartiennent plus au passé ni au futur, mais à cet instant où je vis dans la foi. En ce sens il faut récuser la notion d'histoire du salut qui l'étale et le distribue dans les trois instances temporelles, au lieu de le rassembler dans la seule véritable historicité, celle du présent. Citant un vers de Rilke, Bultmann écrit que Dieu est "le visiteur qui va toujours son chemin"*. On peut dire, me semble-t-il, exactement la même chose du salut tel qu'il le comprend. Il surgit toujours inopinément chez moi, il ne s'y installe pas : à chaque instant, il entre pour la première fois; il m'émerveille, me surprend. De même, chaque matin, dans le désert du Sinaï, la manne tombe du ciel. Les hébreux s'en nourrissent, mais ils ne peuvent pas l'emmagasiner, faire des réserves ou des provisions; stockée, elle s'altère, s'abîme, devient immangeable. Quand le jour se lève, la manne, le salut vient à nouveau sur des gens toujours aussi démunis. On ne vit pas de ce que Dieu a donné hier, mais de ce qu'il donne aujourd'hui. Dans cette perspective, rien de plus contradictoire et antinomique avec la foi que l'habitude, ou que l'habitus. Le salut, passé de la foiLa troisième attitude est assez fréquente chez les réformés. Comme les luthériens, ils conçoivent la grâce comme la décision divine de ne pas tenir compte du péché, d'entrer en relation avec le pécheur et de l'adopter malgré sa faute. Cependant, à la différence des luthériens, ils estiment qu'il s'agit d'une décision prise et inscrite dans la vie croyante une fois pour toutes. Le salut prend place au début de la vie chrétienne; il en constitue le moment initial, le point de départ. Il ne se répète pas ni ne se renouvelle à chaque instant. Il est acquis, définitif; rien ne peut nous en priver, ni l'empêcher d'opérer en nous. Dans cette perspective, les réformés, ce qui les distingue des jansénistes, estiment qu'on ne peut pas vraiment perdre la foi (ce que, par exemple, soutient Karl Barth). En effet, notre relation avec Dieu ne dépend pas de ce que nous sommes, faisons, sentons, croyons, ni de ce dont nous avons conscience, mais uniquement de la volonté et de l'action de Dieu. Elle ne peut pas donc se rompre, puisque Dieu ne change pas. Si selon la première réponse le salut se situe dans l'avenir et représente le but vers lequel je me dirige avec l'aide de Dieu, si pour la deuxième il se trouve dans le présent que je vis, dans la troisième il relève du passé. Le salut nous a été donné, accordé. Il n'y a pas à y revenir ni à s'en préoccuper. Il s'agit d'un problème résolu, d'une affaire réglée et classée. Le Réformateur de Strasbourg, Martin Bucer écrit : "le croyant n'a pas à se tracasser pour son salut individuel, car il sait que le Dieu éternel et paternel a fait ce qu'il fallait pour son cher enfant". Dans les testaments réformés français du dix-septième siècle, on constate cette tranquille assurance. Alors que les catholiques les commencent par de longues introductions qui implorent la grâce de Dieu, qui sollicitent l'intercession de Marie et des saints, qui demandent que l'on dise des prières et que l'on célèbre des messes pour le repos de leur âme, les réformés constatent avec sérénité que Dieu les a sauvés, ils en prennent acte avec un mot de louange et de reconnaissance, puis, très vite, ils passent aux legs; ils n'expriment aucun souci quant à leur salut. Au dix-neuvième siècle, le calviniste genevois César Malan déclare : "C'est offenser Dieu que de le prier pour un salut qu'il nous affirme avoir accompli". J'ai été sauvé il y a deux mille ans à Golgotha; mon salut remonte même plus haut, à un décret éternel de Dieu antérieur à la création du monde. Il appartient à l'histoire ancienne. Que le Christ soit mon sauveur constitue un acquis irréversible et inamissible. Il faut maintenant qu'il devienne le Seigneur de ma vie : cela seul doit me préoccuper. L'évangile me délivre et me débarrasse du problème de mon salut, en m'annonçant que le Christ l'a résolu. Il m'oriente vers une autre question : celle de la gloire de Dieu, c'est à dire celle de sa souveraineté de Dieu dans ma vie et dans le monde, celle du témoignage à lui rendre, celle de son règne à établir ou à rendre visible. Le réformé classique est un militant de Dieu, un combattant pour sa justice et son Royaume, sans aucune anxiété pour son sort, sans angoisse pour sa personne. Il n'agit pas, il ne travaille pas, il ne lutte pas afin obtenir le salut, mais parce qu'il l'a obtenu. Il n'y voit pas le but à atteindre; il le considère plutôt comme le début, le commencement de la vie croyante, la force qui nous met en marche et qui nous mobilise. Significativement, le Nouveau Testament le compare à nouvelle création, à une genèse qui rend possible une histoire. Dans cette perspective, le croyant ne s'interroge pas sur le salut, mais à partir du salut. ConclusionDans les parties précédentes, j’ai exposé et analysé des positions différentes sans beaucoup prendre parti. Je vais maintenant, brièvement, me prononcer, dire ce que représente pour moi le salut. Je pense et je crois que le salut évangélique a pour caractéristique essentielle de nous mettre en marche, de nous permettre ou de nous contraindre d'avancer; il fait naître un dynamisme qui nous porte et nous emporte. Le catholique Raymond Pannikar oppose à juste titre deux conceptions du salut : celle qui en fait la réparation d'un accident, la restauration d'un état primitif, le retour à un paradis perdu, et celle qui y voit l'invention d'une réalité originale, le surgissement d'une situation inédite* (cf. la première partie de ce cours, le § 3). Une prédication de Paul Tillich (cf. la fin de la troisième partie) prononcée à l'occasion de Noël compare le salut à un bébé* : il inaugure une vie nouvelle, il oriente vers un avenir, il annonce l'enfant et l'adulte. Tout part du berceau, mais il faut en sortir. Dans une lettre publiée dans la revue Études théologiques et religieuses, Albert Schweitzer reproche à la théologie, à la prédication et à la catéchèse chrétiennes traditionnelles de regarder trop en arrière à la rédemption accomplie et pas assez vers le Royaume qui vient*, de se livrer à une constante fouille archéologique pour retrouver ses bases et de perdre le dynamisme eschatologique de l'évangile. Ne nous arrive-t-il pas, en effet, à l'image de la femme de Lot, de tourner tellement les yeux vers la catastrophe à laquelle nous avons échappé que nous nous figeons dans une statue certes de sel, mais certainement pas du sel de la terre ? Je cite volontairement dans cette conclusion un auteur catholique, Pannikar, et deux luthériens, Tillich et Schweitzer, à l’appui d’un thème plutôt réformé, mais dont les réformés n’ont nullement le monopole. Il me conduit à penser que parler du salut aujourd'hui signifie précisément ne pas trop en parler, ne pas trop s'en préoccuper, ne pas trop s'inquiéter de nous-mêmes, de ne pas trop s'inquiéter de la spécificité de notre message, mais de travailler à construire en nous cette créature nouvelle et autour de nous cette création nouvelle que le salut rend possible et auquel l'évangile nous appelle. L’évangile évacue ou plutôt règle la question du salut, de sorte qu’il n’y a plus à s’en préoccuper. André Gounelle Notes :*Romains 1,16 * Voir l'excellent petit livre de L. Gagnebin, Albert Schweitzer, Desclée de Brouwer, 1999. * Apocalypse 21, 5 * Matt. 9/12 et Marc 2/17. * 1. Cor.15, v.45. * Romains 8, 19-22. * 1. Cor. 15/22. * 1 Pierre, 4,6. Cf. 1 Pierre 3/18-20. * Ephésiens 2,8. * Décret sur la justification du 13 janvier 1547, premier canon (G.Dumeige, La foi catholique, Orante, 1975, p.356) * cité d'après E.W.Gritsch et R.W.Jenson, Lutheranism, Fortress Press, 1982, p.51 * Décret sur la justification du 13 janvier 1547, ch.5 (G.Dumeige, op.cit., p.347-348) * R.de Pury, Qu'est-ce que le protestantisme ? Les Bergers et les Mages, 1961, p.54. * Décret sur la justification du 13 janvier 1547, ch.8; cf.ch.10 (G.Dumeige, op.cit., p.350). * voir J.Ansaldi, Ethique et sanctification, Labor et fides, 1983, p.92, 111-112. * R.Bultmann, Foi et compréhension, Seuil, v.2, p.144. * R.Pannikar "La religion comme liberté" dans les actes du colloque de Rome de 1968, L'herméneutique de la liberté religieuse, Aubier, p.75-76 * P.Tillich, L'être nouveau, p.132. * A.Schweitzer, "Lettre inédite", Etudes théologiques et religieuses, 1985/2.
|
|
André Gounelle Professeur émérite de la faculté de théologie protestante de Montpellier Webmaster : Marc Pernot (JechercheDieu.ch)
|