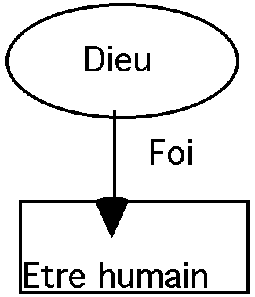|
La foi1. La foi une relationLa foi est essentiellement une relation, un "croire en quelqu'un" et non un "croire quelque chose". Quelles sont les caractéristiques de cette relation. 1. Une relation dont nous n'avons pas l'initiativeNous n'avons pas la capacité ou le pouvoir de la provoquer. La foi vient de Dieu, elle nous prend; elle s'empare de nous. Elle ne résulte pas d'une décision ou d'un choix délibéré de notre part; elle arrive et s'impose à nous. Comme l'écrit Paul dans Eph.2/8 : "Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu". Entre parenthèses, dans ce verset, "cela" désigne non pas directement et immédiatement la foi, mais le salut que nous recevons de la grâce par le moyen de la foi. Néanmoins, quand on lit cette phrase dans son contexte, il paraît évident que le "cela" comprend, englobe la foi. Dans la perspective de Paul, on ne peut pas séparer et dissocier foi et salut. La foi dépasse l'être humain, et ne peut pas se comprendre seulement, uniquement, ni même principalement à partir de lui. Contre la tendance catholique à faire de la foi un acte humain, la Réforme réagit fortement. Elle va jusqu'à la thèse absurde et, à certains égards, monstrueuse, de la double prédestination pour mettre en évidence que l'origine et la source de la foi se trouvent en dehors du croyant, que sa foi dépend d'un acte et d'une décision de Dieu à son égard, et non de lui-même. Dans la même ligne, Barth condamne catégoriquement et brutalement toute tentative pour faire de la foi un mouvement de la créature vers le créateur, pour y voir une quête, une recherche ou une marche par laquelle nous nous élèverions jusqu'à l'ultime. De son côté, Ebeling affirme que le foi n'est pas une qualité humaine, quelque chose que l'homme posséderait ou pourrait acquérir par ses propres moyens; le mot "foi" est pour lui une manière de nommer la présence et l'action de l'Esprit dans ma vie. Je fais trois remarques sur ce premier thème. 1. Premièrement, personne ne nie que la foi s'inscrit en nous, qu'elle nous marque. Elle suscite des sentiments, elle fait naître des croyances, elle provoque des décisions. Elle ne relève cependant ni de l'émotivité, ni du jugement, ni de la volonté. Même si elle arrive et se produit en l'être humain, elle vient d'ailleurs que de lui, Pour reprendre le vocabulaire de Gisel, qu'elle soit "excès" ne l'empêche pas d'être aussi "croyance incarnée". 2. Deuxièmement, il en résulte que les sciences humaines, l'histoire, la psychologie ou la sociologie, peuvent éclairer des aspects ou des manifestations de la foi. Elles ne peuvent pas la cerner, en rendre compte, car il ne s'agit pas d'un phénomène purement et totalement humain, ou dont l'origine se trouverait en nous. La foi met en jeu l'action d'une altérité, l'intervention d'une transcendance, donc de quelque chose qui par définition échappe à la science ou à une exploration anthropologique. 3. Troisièmement, si on s'accorde largement à affirmer que la foi vient de Dieu, par contre il y a débat et divergence sur ce que suppose et implique le fait qu'elle se produise en nous, qu'elle nous arrive. Si on représente la foi par le schéma suivant, il y a accord sur la flèche qui va de Dieu à l'être humain, mais pas sur le point d'impact de la flèche :
Pour Barth, il n'existe dans l'être humain, aucun point d'accrochage, aucune ouverture, aucune structure d'accueil qui le rendrait réceptif et le disposerait à croire. Il faut non seulement que Dieu se manifeste, mais qu'il fasse le nécessaire pour que cette manifestation nous touche, nous atteigne; il crée en nous la foi ex nihilo. On peut parler, en ce sens, d'un pessimisme anthropologique radical. Au contraire, Brunner, Bultmann et Tillich discernent dans l'homme une insatisfaction, un manque, une aspiration, une recherche, une préoccupation à laquelle répond la venue de Dieu, et qui donne à la foi une dimension profondément humaine. Elle implique une altérité, sans être étrangère à ce que nous sommes; je ne parlerai pas d'optimisme anthropologique, ce serait exagéré, mais d'un pessimisme atténué ou nuancé. Cette divergence va entraîner deux prédications très différentes, la première uniquement kérugmatique (l'évangile comme message venant de l'extérieur), la seconde prenant en compte les situations et les cultures humaines (l'évangile comme réponse à un désir et un besoin). 2. Une relation existentiellement déterminante.La relation de foi a une seconde caractéristique. Elle est pour nous déterminante, elle a un impact et un effet existentiel décisifs. Elle marque en profondeur notre vie et lui donne son orientation d'ensemble. Nos autres relations ont un intérêt secondaire et une portée relative. Je peux changer de voisins, de collègues de travail, et même parfois de conjoint sans que le sens de ma vie soit en cause, sans que cela me mette fondamentalement en question, sans que cela représente une conversion ou une transformation radicale. Au contraire, la foi concerne ma personne et ma personnalité, elle détermine ce que je suis. Paul le souligne en établissant un lien étroit entre la foi et le salut. Dans la perspective biblique, il n'y a rien de plus important et de plus central pour la personne que le salut; ce mot désigne ce qui est pour moi essentiel et décisif. Tillich exprime la même idée en parlant d'ultimate concern. Dans ma relation avec Dieu se joue la vérité et le sens de mon existence; à la différence des autres relations, elle a une importance ultime. 3. Une relation vivanteTroisième caractéristique : la relation de foi est vivante, et non structurelle ou "objectivante", pour reprendre le vocabulaire de Bultmann. Elle ne nous assigne pas une place et un rôle bien déterminés dans un organigramme. Nos rapports avec l'État se définissent en terme de lois, de règlements qui indiquent le permis et l'interdit, qui s'occupent de situations et de fonctions, de liens institutionnels, mais non personnels. Il s'agit de maintenir l'ordre et d'assurer la bonne marche de la société, d'empêcher des perturbations. Au contraire, la foi ne relève pas d'un code prédéterminé et anonyme; elle ne se programme pas; elle n'emprunte pas toujours les mêmes chemins, bien balisés. Elle nous secoue, nous bouscule et nous confronte avec de l'inattendu, comme le souligne avec force Bultmann. C'est pourquoi la relation avec Dieu se noue et se concrétise dans une histoire. Un système métaphysique ou une doctrine abstraite n'en rend pas totalement compte et laisse même échapper un élément essentiel. À cet égard, Brunner a raison de souligner, comme le fera plus tard Käsemann, l'importance pour la foi chrétienne des récits évangéliques. Parce que relation vivante, la foi se raconte avant de s'enseigner. En mettant dans le Nouveau Testament les évangiles avant les épîtres (pourtant plus anciennes) et en honorant les évangiles plus que les épîtres (puisque dans les liturgies traditionnelles, on se lève pour la lecture de l'évangile, alors qu'on écoute assis celle de l'épître), les chrétiens ont bien indiqué que la foi parle essentiellement le langage de la narration, même si la théologie ne peut pas s'en contenter, et doit en abstraire des structures ontologiques, comme le souligne Tillich. Je mentionne dans la même ligne l'insistance d'Eliade sur l'historicité, c'est à dire sur une relation d'ordre personnel et non institutionnel avec Dieu. 4. Une relation ouverteEnfin, un dernier élément spécifie la relation de foi : son ouverture. Elle ne se laisse pas enfermer dans une dogmatique ou un rituel. On ne peut pas la figer. Parce que vivante, elle ne cesse d'avancer, d'évoluer, de se modifier. En ce sens, la foi se structure selon les trois dimensions de la temporalité. Elle s'appuie sur un passé, sur ce qui me précède, sur quelqu'un qui vient à moi et me rencontre à travers une histoire qui a eu lieu avant moi et que l'on me raconte. Elle n'est, cependant, pas une pièce de musée. Elle appartient à mon "aujourd'hui". Elle s'inscrit dans mon présent, elle le détermine existentiellement; elle a une actualité qui la rend vivante. Enfin, elle a un avenir : ni l'autrefois, ni le maintenant ne la contiennent. Elle s'oriente vers un avenir qui déborde ce qui a été et ce qui est et qui la maintient ouverte sans lui enlever l'identité que lui confère son passé. Autrement dit, la foi a une orientation eschatologique. Si, comme le dit Apocalypse 1/8, Dieu est celui qui a été, qui est et qui vient, notre relation avec lui a forcément les trois dimensions de l'autrefois dont on se souvient, du maintenant que l'on vit et de l'avenir qu'on attend. 2. Le contraire de la foiLe second thème constitue l'envers ou le corollaire du premier. Pour bien voir en quoi consiste une chose, en bonne méthode, il convient de s'interroger sur son contraire. Demandons-nous, par conséquent, à quoi la foi s'oppose-t-elle. Que nie-t-elle, que contredit-elle? Comment définir l'incrédulité, l'apistia, la non-foi? À cette question, on a donné quatre réponses qui se combinent et s'additionnent et qui correspondent aux quatre points de la première partie. 1. La confiance en soiLa première réponse domine chez Brunner et Barth. Elle correspond à l'insistance sur l'extériorité de la foi. Si elle nous vient d'ailleurs, l'humanisme au sens d'une confiance totale en l'être humain, constitue l'inverse de la foi. Quand on espère arriver par ses propres moyens à donner une valeur même minime à sa vie, quand on pense atteindre par ses seules forces ne fut-ce qu'un bout de vérité, alors on manifeste son incrédulité, car on estime pouvoir se passer en partie de Dieu, n'en avoir pas radicalement et totalement besoin. Si l'on croit un peu en soi, si l'on compte jusqu'à un certain point sur soi, alors on ne croit pas vraiment en Dieu. Autrement dit, l'apistia se caractérise par l'oubli ou l'affaiblissement de l'affirmation du "cela vient de Dieu", par la conviction illusoire qu'un petit quelque chose doit venir de l'être humain. 2. L'indifférence existentielleL'insistance sur le caractère existentiel de la foi se traduit par une seconde réponse, développée surtout par Bultmann et Tillich. Pour eux, ce qui s'oppose le plus diamétralement à la foi, c'est le désengagement de la personne qui se situe en retrait, qui considère qu'elle n'est pas vraiment en cause ou en jeu. Bultmann parle d'objectivation, c'est à dire d'un système d'interprétation du monde qui me permet de garder mes distances envers un Dieu situé et classé. Comme le signale aussi Gisel, il y a opposition entre le "croire que" de la weltanschauung qui fait de Dieu un objet connu, manipulé, utilisé, et le "croire en" de la foi pour qui Dieu est le sujet qui domine ma vie. De son côté, pour Tillich, l'apistia consiste dans le scepticisme ou l'indifférence qui ne prend rien au sérieux, qui ne se sent jamais, nulle part concerné existentiellement, pour qui la vie et le monde se réduisent à un jeu ou un spectacle. Autrement dit, il y a foi seulement quand la question du sens de ma vie se pose pour moi, quand elle me travaille et me balaie tous les échappatoires possibles. 3. La mort de DieuUne troisième réponse se rencontre surtout chez Bonhoeffer et Vahanian qui insistent sur le caractère vivant du Dieu que l'on rencontre dans la foi. À la foi en un Dieu présent, agissant et transcendant, ils opposent la religion, croyance en un Dieu mort. Bonhoeffer n'emploie pas cette expression, mais elle rend bien compte de sa pensée : Dieu devient pour nous comme un mort quand on le situe ailleurs, dans un au-delà ou un en-dedans, dans une transcendance ou une intériorité, dans un autre monde que celui de la réalité, lorsqu'on le cantonne aux limites et qu'on ne le fait intervenir que dans les cas extrêmes. À ce travers qu'il dénonce également, Vahanian ajoute le danger symétrique et inverse, celui d'un Dieu trop bien assimilé, intégré, colonisé qui a perdu son altérité et qui ne nous bouscule plus. 4. Le désespoir.Enfin, Schweitzer et Moltmann voient dans la résignation, l'acceptation, le manque d'espoir le contraire de la foi. Elle consiste à se laisser aller, à estimer qu'il n'y a rien à faire, à démissionner. Cette accentuation se rencontre également chez Brunner, pour qui la confiance en l'homme ne peut que déboucher sur le désespoir, à cause des échecs, des erreurs et des faillites que nous connaissons. On la trouve aussi chez Bultmann, pour qui il y a manque de foi quand on ne s'attend plus à rien, quand aucune nouveauté ne paraît possible. Mais Brunner et Bultmann parlent surtout d'une espérance personnelle. Pour Schweitzer et Moltmann, il s'agit aussi d'une espérance pour le monde, qui suscite une militance active dans le monde. Tillich réunit les deux aspects quand il insiste sur le lien étroit, la presque identité de la foi et du courage. 3. Le croyant1. Le croyant vis-à-vis de lui-même.Que la foi se réfère à une altérité vivante va avoir pour conséquence une tension entre deux pôles : d'un côté la foi va donner une très grande valeur à la personne du croyant, de l'autre elle va la relativiser. Voyons successivement les deux aspects de cette bipolarité. 1. La foi a un caractère éminemment personnel, ce que les théologiens marqués par l'existentialisme, comme Brunner, Bultmann, Ebeling, Tillich soulignent fortement, mais aussi Gisel qui appartient moins à la sensibilité existentialiste. Quand on parle de "croire", il ne s'agit pas d'un mouvement ou d'un phénomène collectif, mais d'un acte de la personne, du sujet individuel. Je n'ai pas la foi en raison de mon appartenance à une famille croyante, à une tradition religieuse, à un groupe social. On n'est pas croyant par conformisme, par éducation, par héritage, ou par solidarité; on le devient parce qu'on a été personnellement rencontré et pris. La Réforme, contre le catholicisme classique qui insiste beaucoup sur la médiation de l'Église, souligne que Dieu s'adresse directement à la personne. Il ne passe pas à travers le système ecclésial. La relation s'établit immédiatement; elle ne transite pas par une série d'instances intermédiaires. Dans la religion, écrit le philosophe Whitehead, il y a un moment fondamental de solitude; il serait plus exact de dire de "tête à tête" avec Dieu. Ceci ne s'oppose nullement à la dimension communautaire de la foi. D'autres êtres humains peuvent certes m'accompagner, m'entourer, m'aider avant ce moment de solitude, me conduire à ce "tête-à-tête"; et, ensuite, après ce moment, la foi me fait entrer dans un peuple ou une fraternité où j'apprends à dire "nous". Néanmoins demeure irréductible cet instant où je dis "je" : personne ne peut me remplacer, se substituer à moi, recevoir le don de Dieu et y répondre en mon nom ou à ma place. Tua res agitur ne cesse de proclamer la Réforme radicale : ta foi, c'est ton affaire, pas celle des autres, de ceux qui t'environnent, des groupes ou de la société dont tu fais partie. 2. Second aspect. Si la foi me concerne personnellement et individuellement, elle vient cependant d'ailleurs, puisque Dieu me la donne, puisqu'elle repose sur une décision et une élection divines. Cette extériorité de la foi détourne le croyant d'accorder trop d'attention ou de donner trop d'importance à ce qu'il est, à ce qu'il fait et à ce qu'il ressent. Dans cette perspective, Barth écrit qu'il est malsain que les chrétiens s'inquiètent "de leurs réactions, de l'émotion et de l'excitation provoquées en eux par l'expérience de la foi". De même, que la foi soit don de Dieu doit écarter des angoisses ou des anxiétés autrement inévitables. Si le salut par foi ne s'accompagne pas du "cela vient de Dieu et non de vous", on tombe dans des introspections et des inquiétudes sans fin quant à la qualité de son existence et l'authenticité de son engagement. Mais si l'essentiel réside non pas dans ce que nous sommes et ce que nous faisons, mais dans ce que Dieu est et dans ce qu'il fait pour nous, alors nous ne nous laisserons pas tourmenter par nos doutes et nos défaillances. Comme le dit Tillich, nous sommes et restons inacceptables, mais qu'importe puisque néanmoins, en dépit de ce que nous sommes, Dieu nous accepte. Ce qui conduit Barth à affirmer qu'on ne peut pas perdre la foi, précisément parce qu'elle ne nous appartient pas (on ne perd que ce qui nous appartient), mais qu'elle vient de Dieu. Les réformés ont proclamé l'inamissibilité de la grâce. Dieu ne change pas; il n'enlève pas, ni ne retire ce qu'il donne. La foi demeure en nous, même quand nous n'en avons plus conscience, même quand nous la croyons irrémédiablement partie, éteinte, disparue. Ces deux aspects se conjuguent. Dans la foi, tout se joue au niveau de la personne humaine, sans que celle-ci ne prenne pourtant une valeur démesurée, sans qu'elle se gonfle exagérément, telle une grenouille qui essaie de devenir un bœuf. Cette bipolarité entre l'existentialité et l'extériorité affirme le caractère décisif de notre personne, sans faire de nous de "petits dieux". La foi chrétienne permet de conjuguer le sérieux (mon existence est en cause, il ne s'agit pas d'un jeu) et l'humour (mon existence ne dépend pas de moi, je peux sourire et me moquer de ce que je suis). 2. Le croyant et le mondeComment le croyant va-t-il se situer dans le monde et par rapport à lui? En réponse à cette question, quatre points se dégagent. 1. Premièrement, le croyant ne condamne ni ne rejette le monde. Il y a une assez grande unanimité pour rejeter une position qui ne verrait dans le monde que du négatif, qui le considérerait comme un tas de fumier et en ferait un lieu démoniaque. 2. Deuxièmement, le croyant ne confond pas Dieu ni ne l'assimile pas avec le monde, ou avec l'un des éléments du monde. Il ne sanctifie pas l'ordre qui existe, ni les événements qui arrivent. Si Dieu est présent dans le monde, il se différencie cependant du monde. 3. Troisièmement, à l'exception de Bultmann avec sa distinction très tranchée entre le domaine de l'objectivable et celui de l'existentiel, nos auteurs refusent de distinguer et de séparer deux règnes. La foi n'est pas à côté du monde, sans relation avec lui. La foi ne consiste pas en une sorte de tête-à-tête amoureux entre Dieu le croyant où chacun contemplerait l'autre, se complairait dans la relation avec l'autre, en oubliant tout ce qui entoure (un peu comme des amoureux qui se regardent dans les yeux et ne voient rien d'autre, qui sont seuls au monde, comme le dit une vieille chanson). La foi mobilise, met au travail, fait entrer dans un combat et une action, engage au service du monde et des autres. 4. Quatrièmement, cette action et ce combat impliquent une relation complexe avec le monde, qui conjugue l'acceptation et l'opposition. On travaille et on se bat pour le monde, contre le monde, contre ce qu'il est, parfois contre ce qu'il veut, mais en sa faveur, afin de l'amener à un mieux. Cette relation s'exprime par la catégorie du "malgré", souligné par de nombreux auteurs : on croit malgré soi, c'est à dire en fonction de ce que l'on est, mais aussi contre des aspects ou des tendances de notre personnalité; on croit malgré ce que l'on voit, c'est à dire en tenant compte de la réalité, mais en lui refusant un caractère normatif, en refusant de s'y soumettre; on croit malgré le monde, c'est à dire ni en s'en évadant, ni en s'y soumettant. Bien évidemment ce "malgré" se traduira de manière différente : dans la polarité "résistance et soumission" de Bonhoeffer, dans la théologie de la culture de Tillich, dans l'iconoclasme de Vahanian, dans la dialectique du pessimisme et de l'optimisme chez Schweitzer, dans celle de l'incarnation et de l'excès chez Gisel. De manière certes diverse, le "malgré" se trouve présent, chez tous nos auteurs. 3. Les croyants des autres religions?Peut-on appeler croyants et considérer comme tels les adeptes d'autres religions? Plusieurs des auteurs que nous avons vus, ainsi Brunner, Barth, Ebeling, Eliade, affirment que la foi, au sens strict du terme, ne se rencontre que dans le christianisme, et qu'elle en constitue la spécificité. À l'appui de cette affirmation, ils donnent deux arguments. 1. Le premier se présente comme la constatation d'un fait. Dans aucune autre religion, on n'accorde à la foi une importance aussi décisive, aussi déterminante, on ne met autant l'accent sur elle. À tel point que si on veut caractériser le christianisme, indiquer sa spécificité, il faut le qualifier de "religion de la foi". Brunner ajoute que nulle part ailleurs, quand on parle de la foi, on ne la comprend comme "abdication de soi à Dieu", autrement dit comme renoncement radical à soi et confiance mise entièrement en Dieu. J'avoue que cet argument ne me paraît pas très convaincant. On pourrait lui opposer, me semble-t-il, bien des exemples, dans le judaïsme, l'Islam, et même dans le bouddhisme, où les fidèles de ces religions apprennent à mourir à eux-mêmes et s'en remettent entièrement à une transcendance. Qu'il y ait une forme de foi propre au Nouveau Testament et au christianisme, on peut effectivement le soutenir; qu’on puisse en conclure qu'il n'existe pas, ailleurs, d'autres formes de foi, et qu'on ne rencontre la foi que dans le christianisme, je n'en suis pas convaincu. Pour ma part, je parle volontiers de foi juive, musulmane et bouddhiste, sans pour cela estimer qu'il s'agit d'une foi de même type et de même structure que dans le christianisme. Il ne faut pas que les différences cachent les analogies. On ne doit pas trop vite ramener les formes de foi à l'unité, mais il ne fait pas non plus nier trop rapidement qu'il existe des parentés. 2. La thèse qu'il n'y a de foi que dans le christianisme s'appuie sur un second argument qui a un caractère plus franchement théologique. La foi, avons-nous vu, consiste dans une relation. Or, affirme-t-on, Dieu établit le contact avec les êtres humains, entre en relation avec nous uniquement en Christ. En dehors de Jésus, Dieu demeure inaccessible, étranger et ignoré. Seule l'incarnation rend possible la foi, c'est à dire une relation vivante et authentique avec Dieu. Ce second argument repose sur un postulat qui ne va pas de soi et que n'acceptent pas tous les penseurs chrétiens, à savoir que Dieu ne se manifeste que dans la personne de Jésus. Je ne peux pas entrer maintenant dans cette discussion complexe (vous en trouverez des éléments dans mon livre Le Christ et Jésus), mais il faut souligner le présupposé christologique de cette position. En théologie systématique, les questions se tiennent, et j'indique seulement l'interdépendance de deux thématiques, sans l'explorer. 4. Le non croyantExiste-t-il vraiment des non-croyants? Si on voit dans la foi une spécificité du christianisme, on répondra évidemment "oui", car quantité d'être humains ne se réclament pas de l'évangile, l'ignorent ou ne l'acceptent pas. Si on fait de la foi une attitude ou une relation qui existe ailleurs que dans le christianisme, qui le déborde, la question devient plus complexe. Elle appelle, me semble-t-il, trois remarques. 1. D'abord, pour Barth, comme pour Tillich, tout être humain a un Dieu, c'est à dire quelque chose qui a pour lui une importance ultime. On peut le considérer comme dépourvu de foi, au sens chrétien de foi en Christ, mais en tout cas pas comme athée. Il a une préoccupation ultime et donc une relation avec l'ultime qui se manifeste d'une manière ou d'une autre. Peut-elle servir de point d'appui pour une annonce de l'évangile? Barth pense que non, qu'elle un obstacle qu'il faut détruire. Tillich estime, au contraire, que oui, qu'il y a un chemin qui va de l'idole vers le vrai Dieu. Il en résultera deux prédications très différentes. 2. Ensuite, si l'être humain reçoit sa foi, mais ne l'acquiert pas par ses recherches et ses efforts, si elle vient de Dieu qui la donne aux uns et non aux autres, il en résulte logiquement que l'on doit peut-être plaindre celui qui ne l'a pas, mais, en tout cas, ne pas l'accuser. Qui songerait à blâmer un aveugle parce qu'il n'y voit pas? De la même manière, on ne doit pas reprocher à quelqu'un de ne pas croire puisqu'il ne peut pas faire autrement, puisqu'il n'est pas maître de sa foi. Dans cette perspective, on comprend qu'à plusieurs reprises dans l'histoire, les chrétiens ont traité beaucoup plus durement les hérétiques que les païens ou les fidèles d'autres religions. Les hérétiques ont reçu l'évangile, ont été touchés par lui et le pervertissent; ils font un mauvais usage de la foi que Dieu leur a donnée; on voit donc en eux des coupables qu'il faut châtier. Les non chrétiens n'ont pas reçu l'évangile; on les considère plutôt comme des victimes ou des infirmes que l'on ne peut pas rendre responsables de leur manque de foi, puisque Dieu ne la leur a pas donné. 3 Vahanian souligne de manière très forte et très juste que dans une perspective chrétienne, il est essentiel qu'il y ait de la foi parmi les êtres humains. Si l'alliance caractérise le Dieu biblique, il s'ensuit, dit-il, que la relation avec les croyants fait partie de l'être du Dieu biblique, en est un élément constitutif. Si la foi disparaît sur terre, si plus personne ne vit la présence transcendante de Dieu, cela signifie par conséquent que ce Dieu n'existe pas, parce que le Dieu biblique est Emmanuel, Dieu avec nous. On trouve une position en même temps proche et différente chez les théologiens du Process. Selon eux Dieu agit dans le monde et sur les êtres humains de multiples manières. Cette action s'exerce aussi là où l'on ne croit pas en lui. Même si on ne la perçoit pas consciemment, sa présence transcendante opère, et ne dépend donc pas de la foi. La foi ne crée pas notre lien avec Dieu, elle le rend conscient. À l'appui de cette thèse, on peut citer la question de Jésus dans Luc 18/8 : "quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre?" L'absence de foi n'empêche pas le Fils de venir pour transformer le monde. Il n'a donc pas besoin de croyants pour vivre et agir. Pour les théologiens du Process, au centre ou au cœur du christianisme, il y a bien l'affirmation de la présence transcendante de Dieu et de son action transformatrice. Là dessus ils s'accordent avec Vahanian, mais ils en diffèrent en ce que pour eux, cette présence ne se manifeste pas seulement, et cette action ne s'opère pas uniquement dans la foi. A leurs yeux, l'importance donnée à la foi traduirait la tendance du croyant à tout centrer sur lui, en oubliant que Dieu déborde infiniment le peuple des fidèles. 4. Foi et liberté1. Le problèmeDans La captivité babylonienne de l'Église , Luther écrit : la foi "est l'œuvre de Dieu, non de l'homme, ainsi que Paul nous l'a enseigné. Toutes les autres œuvres, il les accomplit avec nous et par notre moyen, mais celle-ci est la seule qu'il accomplisse en nous et sans nous". Osiander, un disciple de Luther, commente cette phrase en qualifiant la foi d'actus passivus. Autrement dit, nous sommes objets passifs de la grâce divine, et non pas vraiment sujets actifs et responsables de notre foi. Elle nous prend, s'impose à nous, s'empare de nous; nous ne la choisissons pas. Dieu la suscite, la provoque, il suscite l'adhésion du croyant, sa réponse positive à l'évangile; en quelque sorte, à travers nous, il se dit "oui" à lui-même. Cette affirmation que "tout vient de Dieu" pose le problème de la liberté humaine. N'y a-t-il pas opposition, contradiction, antinomie entre foi et liberté? N'avons-nous vraiment aucune part, aucune responsabilité dans notre foi? Sommes-nous simplement des marionnettes manipulées par une puissance supérieure? Quand l'apôtre Paul se dit esclave, doulos, du Christ n'exprime-t-il plus profondément et plus justement la condition du croyant que lorsqu'il parle de la liberté chrétienne? Et les critiques de la religion n'ont-ils pas raison d'y voir une aliénation ? 2. La réponse classiqueÀ cette objection, on oppose en général une argumentation que j'expose en trois étapes 1. Elle fait, d'abord, appel à l'analogie avec l'amour qui semble particulièrement appropriée et éclairante. Je ne décide pas d'aimer un tel ou une telle; je "tombe" (mot significatif) amoureux. Pourtant, quand il s'agit d'un amour heureux, c'est à dire qui n'échoue pas d'une manière ou d'une autre, je ne le ne vis pas ni ne l'éprouve pas comme une contrainte, un esclavage ou une aliénation. Au contraire j'y vois quelque chose qui m'épanouit, m'accomplit; je le considère comme mien, parce qu'il exprime, souvent mieux que mes choix délibérés et conscients, ma personnalité. Je suis pris, et portant je me sens libre. 2. Ensuite, dans un second temps, cette expérience amène à contester la manière dont en général la culture contemporaine comprend la liberté pour revenir à une conception plus ancienne. Aujourd'hui, en Occident, on s'estime libre quand on a la possibilité d'opter entre plusieurs possibilités, lorsqu'on se trouve devant un choix à faire sans contraintes extérieures ou intérieures. Le vote démocratique sert ici de modèle ou de paradigme. Il exige trois conditions : d'abord, l'arrêt de la campagne électorale vingt-quatre heures avant le scrutin pour assurer un temps de réflexion qui permet de prendre intérieurement du recul par rapport de la propagande; ensuite, le passage par l'isoloir qui me soustrait à toute pression d'autrui; enfin, la multiplicité de bulletins qui me permet de choisir. Il s'agit d'assurer le plus possible l'indépendance, l'autonomie du sujet. Autrement dit, la liberté ainsi conçue consiste dans l'exercice sans entrave de ce que la philosophie appelle "libre arbitre". Au contraire, les cultures et les philosophies anciennes, mais aussi l'existentialisme, considèrent très souvent que la liberté la plus profonde, la plus réelle ne se définit pas par le choix, mais par l'authenticité. Selon une définition donnée par le Vocabulaire de la philosophie de Lalande, la liberté est "l'état de l'être...qui agit selon sa nature". Elle ne consiste pas à trancher entre plusieurs options, mais à vivre et à agir selon la vérité profonde de son être. Quand on dit, comme Luther à Worms, "je ne puis autrement", alors on est pleinement libre, car il y a une coïncidence totale entre ce que nous sommes et ce que nous faisons. Or, notre authenticité ne réside pas dans un isolement artificiel, mais dans un réseau de relations. Plus précisément, Dieu est la vérité de l'être humain; quand il s'impose à nous, il ne nous contraint pas, il nous rend libres, parce qu'il nous permet de devenir nous-mêmes, d'accéder à une existence authentique. 3. À partir de ces considérations, les réformés, s'engagent dans une troisième étape, plus dogmatique qui tire les conclusions des deux précédentes. Ils affirment qu'il n'y a pas antinomie entre la totale souveraineté de Dieu et la pleine liberté de l'être humain. Loin de s'opposer, elles s'impliquent mutuellement. Le néo-calviniste Auguste Lecerf exprime cela de manière paradoxale et contestable en écrivant que Dieu a une puissance telle qu'il peut nous faire faire librement ce qu'il veut que nous fassions. Il me paraîtrait plus juste de dire que la volonté de Dieu exprime, traduit ce que nous sommes vraiment, qu'elle correspond à la vérité de notre être et qu'à cause de cela, même quand elle nous force, nous oblige, elle nous ouvre à la liberté; un peu comme en me contraignant à faire des études, on a plus augmenté ma liberté que si on m'avait laissé tranquille. 3. L'anthropologie sous-jacenteIl me semble que cette réponse reste insuffisante et qu'il faut l'approfondir, aller jusqu'à ses fondements anthropologiques ou ontologiques pour en faire apparaître la pertinence. Je vais le faire rapidement en m'appuyant sur une analyse de Tillich qui distingue deux sortes de théologies qui se distinguent par la manière dont elles conçoivent la relation de Dieu avec l'être humain. 1. Pour la première, l'extériorité et l'altérité de Dieu signifient qu'il nous est étranger. Il n'y a rien de commun entre lui et nous, et rien ne nous prédispose à entrer en relation avec lui. Sa parole présente une telle hétérogénéité avec tout ce que nous sommes et vivons que pour la comprendre, il faut qu'il crée lui-même sa propre écoute en nous. Nous ne l'entendrons pas s'il ne nous donne les oreilles qui nous manquent. Il est le tout-autre, qui arrive du dehors, d'ailleurs et qui cherche à prendre possession de nous, un peu comme ces "envahisseurs" des films de fiction qui viennent d'une autre planète pour dominer et asservir la terre et ses habitants. S'ils réussissent, les terriens perdront toute autonomie et toute indépendance; ils deviendront des esclaves. De même, la puissance de Dieu détruit et supprime la liberté humaine. La foi consiste à se soumettre, à obéir; nous n'avons même pas à consentir à notre servitude, ce consentement s'impose à nous. Nous disposons d'une relative liberté dans nos relations sociales ou humaines, mais pas à l'égard de Dieu. Il dispose de nous et nous façonne comme le maître potier le fait pour l'argile. 2. La seconde sorte de théologie insiste, au contraire, sur le lien congénital qui existe entre Dieu et nous. Dieu nous a crée, il nous a conféré notre être, il lui a donné sa structure et sa forme, ce qui permet à la Genèse de nous qualifier d'image de Dieu, et à Paul de dire à Athènes que nous sommes de la race de Dieu. Le thème de la création signifie que fondamentalement nous avons une relation avec Dieu et que de ce fait il se trouve ontologiquement ou structurellement présent en nous. "En lui nous avons le mouvement, la vie et l'être" dit encore Paul à Athènes. Certes, ce lien fondamental et constitutif de notre être a subi une détérioration à cause du péché qui nous empêche de le percevoir, qui nous abîme et nous fausse, qui nous endommage, nous dérègle et nous dégrade. À cause du péché, nous vivons, existons en dehors de notre propre vérité, elle nous échappe, nous n'y avons plus accès. Je rejoins là le thème de Bultmann qui souligne le caractère problématique, énigmatique et incompréhensible de l'existence; et le thème de la question chez Tillich : l'homme est fondamentalement et inévitablement question, parce que dépourvu, mutilé de quelque chose qui lui appartient en propre. Pour que nous découvrions notre vérité, il faut que Dieu nous parle et nous saisisse du dehors, nous répare en quelque sorte par une intervention extérieure, ce qu'il fait par l'évangile. Du coup, la parole divine, bien que venant d'ailleurs que de nous, ne constitue cependant pas un corps étranger, semblable à un aérolithe tombant d'une autre planète. Quand elle nous rencontre et pénètre en nous, "elle vient parmi les siens", comme le dit le prologue de Jean. Elle rencontre une vérité qui réside en nous, même si le péché l'a obscurcie et défigurée, et du coup nous pouvons l'accueillir, la reconnaître. Barth me semble avoir raison quand il affirme que "nous ne pouvons pas provoquer notre communion avec" Dieu; mais je crois qu'il a tort d'en conclure qu'il n'y a en nous rien "qui pourrait être appelé une disposition à entendre la Parole de Dieu"; à mon sens, comme le soutiennent contre Barth, Bultmann, Tillich et Brunner, il existe un point d'accrochage ou d'ancrage pour la foi qui tient à notre condition de créature. La parole de Dieu s'impose à nous, parce qu'en l'entendant et en la recevant nous nous trouvons nous-mêmes. Même si elle s'empare de nous, même si elle agit "en nous sans nous", elle ne nous prive pas de notre liberté, mais nous la restitue. On peut illustrer ce type de théologie en servant du conte de "la belle au bois dormant" comme d'une sorte de parabole. La princesse, figure de l'humanité, est victime d'un sortilège qui la plonge dans un long et profond sommeil; image du péché qui nous empêche d'être nous-mêmes. Pour que la belle se réveille et retourne à une existence normale, il faut que le prince vienne l'embrasser, image de la révélation ou de la parole qui arrive du dehors. Tout seule, elle continuerait à dormir, à ignorer ce qu'elle est vraiment, à se trouver en dehors de sa condition normale, à demeurer cachée, stérile, inféconde dans son palais oublié. Elle a besoin d'un secours extérieur; seule elle ne peut rien faire. De son côté, le prince s'il ne trouve pas de belle à embrasser errera inutilement et inefficacement à travers les bois; la révélation externe resterait impuissante si elle ne trouvait pas un récepteur adapté, si elle ne correspondait pas à une vérité fondamentale, enfouie et masquée en nous, qu'elle éveille et restaure, pour reprendre une expression de Brunner. Sa force de conviction, sa puissance qui s'impose viennent de ce qu'elle nous rend à nous-mêmes, à notre vérité, c'est à dire à une relation vivante et aimante avec Dieu, notre créateur. 4. Prolongements théologiquesJe termine cette partie par deux prolongements théologiques que j'indique rapidement. 1. Cette ontologie de la foi montre, me semble-t-il, l'importance fondamentale de la création. Quand la théologie l'ignore ou la néglige, la considère comme secondaire ou subordonnée, quand elle veut accorder une attention exclusive au salut, alors elle se déséquilibre. Pour ma part, je reproche à Barth de vouloir tout centrer sur la christologie, de ne pas donner à la création la place qui lui revient, et du coup d'éliminer de manière abusive la religion. Je trouve frappant de voir que dans les éditions successives de l'Institution chrétienne, la création prend une place grandissante. Mais à l'inverse, une théologie qui se centrerait uniquement sur la création, et ne s'intéresserait que subsidiairement au salut fausserait tout autant les choses. L'évangile ne trouve tout son sens que dans la bipolarité de la création et du salut, dans la tension entre d'une part la parole interne qui nous crée, nous constitue, nous suscite, et d'autre part la parole externe qui nous sauve, nous révèle ce que nous sommes et nous ressuscite 2. Barth, Bultmann et Tillich s'accordent pour affirmer, et je pense avec raison, qu'on ne peut pas traiter de la foi dans le cadre de la relation "sujet-objet" qui suppose des êtres placés à côté les uns des autres, comme des objets. Dans le cas de Dieu, on a des liens et des rapports d'un autre ordre. Que Dieu soit autre et extérieur, ne signifie pas qu'il soit pour nous totalement étranger. Il se trouve à la fois hors de nous, extra nos, et en nous, plus proche de moi que je ne le suis moi-même, disait Augustin; sa différence et sa transcendance se conjuguent avec une intimité et une proximité ou, plus exactement, avec une immanence. Si on ne prend pas en compte ce caractère unique de notre lien avec Dieu, on ne peut pas, me semble-t-il, résoudre le problème de la liberté, ni bien comprendre la nature de la foi. ConclusionJe conclus par une dernière et brève remarque. La foi présente une sorte d'ambivalence et de bipolarité que je formulerai ainsi : d'un côté elle semble très faible et vulnérable, de l'autre elle paraît avoir une puissance indestructible. Faible, elle l'est à cause de ce "malgré" que nous avons souligné. Constamment ce que nous sommes, ce que nous vivons, et ce que nous voyons semble la contredire; sans cesse, elle se voit attaquée, menacée par quantité de déviations qui risquent de rompre un équilibre fragile entre divers pôles. La foi, et en cela elle est non seulement vulnérable, mais aussi dangereuse, risque de sombrer dans l'idolâtrie, dans le fanatisme, dans la superstition obscurantiste, dans l'utopie, dans l'irréalisme, dans l'absurde. Et pourtant, d'un autre côté, la foi manifeste une vitalité et une puissance qui paraissent indestructibles. Elle ne cesse d'habiter et d'animer des êtres humains, de les rendre solides et lucides, de les soutenir et de les redresser. Elle ne rend pas forts, mais elle donne une force invincible. Il me semble que la foi illustre de manière exemplaire la phrase que Paul déclare avoir reçu du Seigneur dans 2 Corinthiens 12/9 : "ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse". Paul ne mentionne pas ici explicitement la foi, et pourtant cette parole exprime peut-être la chose la plus importante qu'on puisse en dire de la foi; c'est en tout cas celle que pour ma part je dis en dernier. André Gounelle
|
|
André Gounelle Professeur émérite de la faculté de théologie protestante de Montpellier Webmaster : Marc Pernot (JechercheDieu.ch)
|