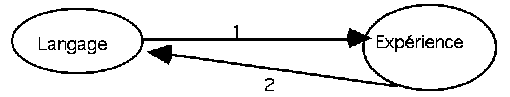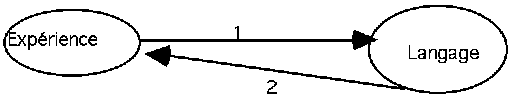Recherche sur AndréGounelle.fr : |
Accueil > Théologie des religions
Théologie des religions
Les relativismes -
Deuxième partie : Compartimentage des religionsIntroduction : modernité et postmodernité
Nous commençons cette étude des relativistes par ceux qui compartimentent les religions (nous verrons ensuite ceux qui préconisent sinon de les fusionner du moins de les allier). Pour illustrer cette première démarche relativiste, j'ai choisi deux exemples qui me semblent caractéristiques. Nous nous arrêterons, d'abord, sur la réflexion de l'allemand Ernst Troeltsch, qui, au début du vingtième siècle, cherche à articuler le christianisme avec la modernité, ensuite sur celle de l'américain George Lindbeck, un contemporain, qui s'inscrit dans le cadre de la postmodernité. Malgré cette différence de contexte et de génération, il y a entre ces deux penseurs une parenté ou une analogie (en tout cas sur le problème qui nous occupe) qui permet de les rapprocher et de les placer dans la même catégorie. Je précise que ni l’un ni l’autre n’accepteraient cette classification ; ils considéreraient qu’elle simplifie et fausse leur pensée. Ce qui est exact. Ils ne préconisent nullement un compartimentage ; toutefois, qu’ils le veuillent ou non, leurs thèses alimentent et favorisent des positions qui vont dans ce sens.
Avant de présenter successivement ces deux penseurs, je donne une indication rapide sur les notions de « modernité » et de « post-modernité ». Dans l'évolution de la civilisation occidentale, durant les deux millénaires qui nous précèdent, on a pris l'habitude de distinguer des étapes et des époques successives qui se différencient les unes des autres par leur mode de vie, leur organisation sociale, politique et religieuse, par leurs valeurs morales, intellectuelles et artistiques. « Moderne » qualifie une de ces périodes. Le seizième siècle marque le début de la modernité, avec les grandes découvertes (qui élargissent l'espace connu et changent la perception du monde), avec l'humanisme (amorce d'une pensée laïque, soucieuse de rigueur intellectuelle), et avec les Réformes de l'Église (qui entraînent un pluralisme religieux). À la fin du dix-huitième siècle, on franchit un deuxième seuil marqué par l'indépendance des États-Unis d'Amérique et la Révolution française qui mettent fin à l'ancien régime, ainsi que par les grandes « critiques » de Kant qui marquent l'avènement d'une nouvelle manière de penser. Enfin, au dix-neuvième siècle, la révolution industrielle, l'essor de la science, et le surgissement d'un art qui rompt avec l'académisme conduisent la modernité à son apogée. L’avènement et le développement de la modernité signifient que ce qui l’a précédée (la manière de penser et de vivre de l’Antiquité et du Moyen Age) est devenu caduque, obsolète, dépassée et n’a plus cours. On se sert désormais d’autres catégories, d’autres conceptualités, d’autres démarches. Ceux qui continuent à utiliser les anciennes sont anachroniques, ce sont les reliquats d’un monde en voie de disparition.
Le terme de « postmodernité », au contenu souvent vague, équivoque, voire contradictoire, entend exprimer le sentiment, voire la certitude de vivre aujourd'hui une période de transition culturelle, où l'on quitte ce qu'on appelle « les temps modernes » pour entrer dans une nouvelle époque que l'on nomme « la postmodernité », aux contours encore imprécis, mais en rupture avec la modernité. D’autres valeurs, d’autres démarches, d’autres manières de penser et de vivre sont en train de se mettre en place. Troeltsch et Lindbeck ont en commun de plaider pour que le christianisme tienne compte de l’actualité, s’y adapte (ce qui veut dire qu’il en tienne compte et non pas qu’il s’aligne ou se conforme) ; mais cette actualité n’est plus du tout la même au début du vingtième et au début du vingt-et-unième siècle ; il y a cent ans elle se définit par la modernité et aujourd’hui par la postmodernité.
1. Ernst Troeltsch
1. Présentation
Ernst Troeltsch est né en 1865. Il enseigne à la fois la théologie et la philosophie d'abord à Bonn, ensuite à Heidelberg, où il se lie d'amitié avec le sociologue Max Weber. Pendant plusieurs années, ils habitent dans la même maison et travaillent ensemble, de concert. En 1915, il est nommé à l'Université de Berlin, en philosophie. Les autorités de l'Église luthérienne, que ses positions inquiètent, s'opposent, en effet, à ce qu'il occupe une chaire de théologie. Tillich écrira qu'après avoir plaidé en faveur de la philosophie dans une Faculté de Théologie à Heidelberg, Troeltsch devint à Berlin le défenseur de la théologie dans une Faculté de Philosophie. En 1914, il refuse de signer le manifeste des intellectuels allemands qui approuve la politique de l'Empereur Guillaume II et la déclaration de guerre, ce qui fait que les nationalistes se méfient de lui. En 1918, il s'engage dans les rangs du Parti démocratique allemand (centre gauche) favorable à la République de Weimar. Il devient député et exerce quelques mois les fonctions de sous-secrétaire d'État (vice-ministre) pour les affaires ecclésiastiques. Il meurt brusquement en 1923, à cinquante-huit ans, à la veille de partir pour une tournée de conférence en Angleterre, en laissant une œuvre inachevée.
Dans les années qui suivent sa mort, son audience, assez grande de son vivant, décroît rapidement. Entre les deux guerres surgit une nouvelle théologie, dont Barth est le représentant le plus connu. Elle ne s'inspire pas de lui et prend même des orientations diamétralement opposées aux siennes. En philosophie, l'arrivée de l'existentialisme détourne de sa philosophie de facture kantienne, et en politique la République de Weimar, qui ne fut jamais très populaire, perd tout prestige. Troeltsch tombe dans l'oubli. Depuis une vingtaine d'années, on redécouvre l'intérêt de son œuvre. On entreprend de la traduire en français trois quart de siècle après sa mort ; des colloques lui sont consacrés; des associations et des programmes d'études s'en occupent. Les écrits de Troeltsch témoignent d'une culture historique, philosophique, sociologique, psychologique et théologique impressionnante. Ils fourmillent d'analyses très informées, très pénétrantes, très éclairantes qui, malgré leur relative ancienneté, n'ont rien perdu de leur pertinence.
2. Théologie et modernité.
Après ces indications bibliographiques, je présente brièvement les orientations théologiques de Troeltsch.
1. Un grand projet anime et domine sa recherche. Il veut penser et formuler la foi chrétienne et plus particulièrement la foi protestante dans les cadres et avec les catégories de la modernité et non plus en utilisant la conceptualité du seizième siècle qu'il juge dépassée, caduque et inopérante. Il estime que le grand tournant de la culture religieuse, politique, philosophique de l'Occident se situe au dix-huitième siècle et non au moment de la Réforme, comme le disent et le croient trop souvent les protestants. Luther et Calvin lui paraissent beaucoup plus proches, par leurs manières de raisonner et par leurs positions, des scolastiques du Moyen Age et des catholiques de leur époque que des protestants d'aujourd'hui. Aux yeux, de Troeltsch, les Églises et les Facultés de théologies se trompent quand elles s'efforcent de maintenir les notions et les argumentations d'autrefois, au lieu de prendre acte et de tirer les conséquences des changements qui sont intervenus. Elles se donnent pour objectif de conserver l'ancien protestantisme et de garder vivant un passé déjà ancien. Elles feraient mieux de définir et de mettre en place un néo protestantisme tourné vers le présent et l'avenir.
2. Qu'est-ce qui, selon Troeltsch, distingue la pensée ancienne de la moderne ? La différence principale vient de ce qu'autrefois et naguère, on situait la vérité au-delà et en dehors du temps. On lui donnait un statut métaphysique ou surnaturel qui la rendait intemporelle ; en quelque sorte on « l'hypostasiait »*. La théologie, la philosophie et la science cherchaient à découvrir et à formuler des propositions valables en tout temps et en tous lieux, indépendamment des circonstances et des contextes. Au contraire, la pensée moderne inscrit son travail et sa réflexion dans le cadre de la temporalité et de la relativité. De la temporalité, car elle a découvert que l'historicité détermine et affecte l'ensemble des réflexions, des connaissances et des réalisations humaines ; elles dépendent de ce qui les précède et de ce qui les entoure et on ne peut pas les comprendre ni les évaluer en les isolant de leur « moment » historique. Par relativité, il faut entendre la relationalité ; est « relatif » ce qui est « relié » à autre chose que lui. La relativité du savoir et de la pensée signifie que toutes les réalités que nous connaissons, toutes nos réflexions, sentiments, idées n'existent, ne prennent forme et n'ont de sens qu'à l'intérieur d'un réseau de relations; « tous les phénomènes ... se conditionnent réciproquement »*. La modernité décrit et explique un phénomène non pas en cherchant ce qu'il est en soi, mais en le situant dans un processus et à l'intérieur d'un entrelacs d'interférences. Elle développe « une vision intégralement historique des choses humaines »*.
3. Selon Troeltsch, la démarche et la conceptualité métaphysiques ont perdu toute valeur et toute pertinence pour nous. Aujourd'hui, nous avons pris conscience que les êtres humains sont entièrement plongés, totalement immergés dans la temporalité. Ils ne disposent d'aucun lieu au-dessus ou en dehors d'elle qui leur permettrait d'en sortir, de connaître autre chose, d'échapper à ses catégories. S'il existe des réalités ou des vérités au-dessus du temps et en dehors de l'histoire, nous n'y avons pas accès. Tout ce que nous vivons, pensons et faisons appartient à un moment du développement historique, marque l'aboutissement provisoire d'un processus, et se modifiera par la suite. Toute réflexion, toute expérience, toute réalisation se situe dans un contexte dont elle dépend et qui la détermine. Ce qui exclut que nous puissions formuler des affirmations définitives et absolues. La science historique « dissout tous les dogmes dans le flux de l'advenir »*. L'honnêteté intellectuelle nous oblige à en prendre acte, à en tenir compte. Autrefois, les théologiens rédigeaient des « dogmatiques » qui entendaient développer des « vérités fixes et immuables ». Aujourd'hui, quand ils sont honnêtes, ils écrivent des « doctrines de la foi » (Glaubenslehre) qui pensent et expriment ce qu'ils ressentent, ce qu'ils croient, ce qu'ils pensent ; ils analysent ce qu'est la foi dans une situation donnée, sans attribuer à leurs propos une validité universelle et intemporelle*.
Troeltsch n'a aucune sympathie ni aucun penchant pour le scepticisme ou l'incroyance. Il croit fermement et profondément en un Dieu qui se trouve en dehors du temps et de l'espace, qui n'est pas soumis au monde et à son histoire. Il est convaincu qu’il existe des valeurs universelles. Il ne nie pas du tout qu'il y ait une transcendance, un au-delà et des réalités qui dépassent le temps. La négation reviendrait, d'ailleurs, encore à poser une vérité éternelle et intemporelle, qui ne serait plus supranaturelle, mais naturaliste. Le problème qui le tourmente ne porte pas sur la foi, mais sur la manière de la penser et de l'exprimer. Pour Troeltsch, une théologie moderne ne cherche pas la vérité hors du monde (ce que faisait le supranaturalisme des époques classiques), elle ne confond pas la vérité avec le monde (ce qui serait du naturalisme), elle cherche la vérité dans le monde, Dieu dans le flux de l'ici-bas, sans pour cela confondre divinité et humanité, éternité et histoire, mais sans, non plus, les séparer. Elle s'efforce de percevoir la transcendance au sein de l'immanence, et de discerner l'éternel à l'intérieur du temporel.
3. Le christianisme religion absolue.
Avant l’avènement de la modernité, la dogmatique traditionnelle fonde tout tranquillement la vérité du christianisme sur une révélation surnaturelle unique en son genre, que signalent et garantissent des miracles. Elle considère qu'en conséquence, la foi évangélique jouit de l'exclusivité de la connaissance de Dieu et qu'elle offre le seul chemin de salut. Les autres religions n'offrent que des imaginations et des inventions humaines. On n'y trouve qu'erreurs et péchés. On les récuse donc d'emblée, par principe, sans examen ni possibilité d'appel. On isole le christianisme ; on voit en lui, dans le monde des religions, une exception ; on en fait une manifestation surnaturelle et divine unique et non un phénomène historique et humain, semblable à bien d'autres. En 1896, un théologien renommé, Julius Kaftan, défend contre Troeltsch et entend maintenir cette démarche traditionnelle : le christianisme est à part, soutient-il, il occupe une place singulière parce qu’il se fonde sur Jésus-Christ, révélation sinon unique du moins suprême et décisive de Dieu. Un élève et ami de Kaftan, Friedrich Niebergall, écrit en 1900, qu’il y a « une profonde coupure entre la religion chrétienne et toutes les autres religions »*, parce que seul le christianisme dérive directement de Dieu ; c’est seulement dans et par l’évangile que nous est communiqué la vie divine. Barth défendra plus tard une position analogue.
Pour Troeltsch, une théologie qui s'inscrit dans le cadre de la modernité ne peut pas accepter cette argumentation pour trois raisons. D’abord, la dogmatique traditionnelle part d'un a priori invérifiable. Rien ne permet d'écarter l'hypothèse qu'il existe une pluralité de révélations divines et que chaque religion ne naisse d'une manifestation temporelle de Dieu. Cette hypothèse apparaît même hautement vraisemblable et Troeltsch la fait sienne. Ensuite, les études des historiens démentent l’affirmation d’une différence radicale entre le christianisme et les autres religions ; il y a de grandes analogies, de nombreuses interférences, des échanges constants, des influences réciproques entre les croyances qui ont cours dans le Proche Orient et celles qu’expriment la Bible ; on ne peut pas séparer Israël de ce qui l’entoure, le considérer comme un cas unique, une religion à part sans faire violence à l’histoire. Enfin, le supranaturalisme de la dogmatique traditionnelle néglige l'historicité et la relativité de toutes les affirmations humaines. On ne peut vraiment plus, sans malhonnêteté intellectuelle, poser d’emblée une différence et une supériorité fondamentales de la Bible en faisant appel à une révélation surnaturelle dont elle serait seule bénéficiaire ; cela revient à ignorer comment elle a été écrite, composée et s’est développée.
Le seul moyen acceptable pour la modernité d'établir la supériorité du christianisme consiste à le comparer à d'autres religions et à montrer, à partir de cette confrontation, que l'évangile représente la religion absolue*, c'est-à-dire la religion où se concrétise complètement le concept de religion, alors qu'ailleurs il ne se réalise que partiellement. La théologie doit faire appel à l’étude des religions pour fonder et justifier ses affirmations. Dans cette perspective, on a qualifié Troeltsch, étiquette qu'il a accepté, de « dogmaticien de l'école de l'histoire des religions », c'est-à-dire de dogmaticien qui s'appuie sur les données de l'histoire des religions pour y fonder ou en déduire ses propositions doctrinales.
Dans un premier temps, Troeltsch s'attelle donc à cette tâche. Il publie en 1902 un de ses ouvrages les plus connus, intitulé L'absoluité du christianisme et l'histoire des religions. Une seconde édition, remaniée et augmentée, paraît en 1912. Il ne faut pas se laisser égarer et tromper par ce titre. Parler de l'absoluité du christianisme, ne signifie nullement, pour Troeltsch*, qu'il aurait le monopole de la vérité et qu'en dehors de lui, on ne rencontrerait que ténèbres, erreurs et mensonges. Cela veut dire que le christianisme correspond totalement à l'essence de la religion, alors qu'ailleurs on ne trouve que des concrétisations partielles ou des incarnations imparfaites de cette essence. Le thème de l'absoluité renvoie à une démarche de type plutôt inclusiviste qu'exclusiviste. Au départ, Troeltsch se propose de montrer non pas que seul le christianisme se fonde sur une révélation mais que l'évangile, qui lui a donné naissance, est « la grande révélation de Dieu aux hommes », et que, par conséquent, la foi chrétienne marque le sommet, le point culminant, le degré suprême et ultime, et donc l'aboutissement du phénomène religieux*.
Deux indications paraissent utiles pour situer ce projet initial de Troeltsch qui s'inscrit dans le cadre d'une culture philosophique de type idéaliste.
1. L'idéalisme est une philosophie qui cherche l'essence des choses, ce qui les caractérise et les définit, ce qui constitue leur réalité la plus profonde. Ainsi, par exemple, l'idéalisme va réfléchir sur la démocratie, en se demandant ce que serait une démocratie pure et parfaite, une démocratie débarrassée de tout élément aristocratique ou totalitaire, une démocratie sans corruption, sans influences occultes, sans magouilles, bref une démocratie idéale et idéelle (idéale parce que rien de non démocratique ne s'y mêlerait et ne viendrait la corrompre si peu que ce soit ; idéelle parce qu'il s'agit, bien sûr, d'une construction de l'esprit, qu'une telle démocratie n'existe et n’existera probablement jamais que dans la pensée ou dans « l'idée » du philosophe). L'idéalisme dégage ainsi l'essence de la démocratie et va s'en servir pour juger et évaluer les différentes démocraties dans le monde, pour proposer des programmes politiques qui augmenteraient le degré de démocratisation d'un pays. Les différents régimes politiques démocratiques se rapprochent plus ou moins de cet idéal démocratique. Imaginons que l'un d'eux le réalise pleinement : il serait « la démocratie absolue », où l'on retrouverait des traits présents dans les autres démocraties, les démocraties relatives. Dans les démocraties relatives, ces traits sont ébauchés, esquissés et parfois brouillés ou parasités par d'autres. Dans la démocratie absolue, ils seraient parfaitement nets et rien ne viendrait les altérer. De même, pour la théologie idéaliste, il existe des religions relatives, qui ont de la valeur et de la vérité ; tandis que le christianisme représente la religion absolue, la religion ayant atteint la perfection, « la religion de toutes les religions », selon une expression de Schleiermacher.
2. L'idéalisme ne voit pas dans les essences des concepts purement logiques, des sortes de schémas mathématiques. Elles représentent, pour reprendre un terme important dans la philosophie de Schelling, des « puissances », des forces qui influencent le cours des choses, qui tendent à se déployer et à se réaliser dans l'histoire. On pourrait suggérer la comparaison avec le code génétique. Nous sommes programmés, et le programme que nous portons en nous de par notre code génétique se déploie dans notre existence : un être parfait serait alors celui qui a complètement accompli le programme de son code génétique (ce qui est, je crois, impossible). Je ne sais pas si biologiquement la comparaison tient ; en tout cas, c'est selon un modèle de ce genre que la philosophie idéaliste pense l'histoire : elle y voit la réalisation progressive de virtualités. Les puissances par étapes successives s'incarnent jusqu'à ce qu'elles existent absolument. Toute la philosophie de l'histoire de Hegel s'inscrit dans cette perspective. Le sens et la logique de l'histoire apparaissent clairement, quand on la comprend comme le développement depuis le germe jusqu'à la fleur et au fruit de l'essence de l'État et de la société, ce qui entraîne d'ailleurs l'idée de la fin de l'histoire quand cette essence se sera pleinement incarnée. Pour en revenir à la théologie, où je me sens plus à l'aise qu'en biologie ou en science politique, on trouve chez certains auteurs mineurs de la fin du dix-neuvième siècle une argumentation simpliste, mais qui, à l'époque, a semblé convaincante. Cette argumentation part du fait religieux considéré comme constitutif de l'essence de l'être humain (l'être humain est un animal religieux). Elle explique, ensuite, que le fait religieux trouve son aboutissement et son accomplissement dans le christianisme, qui est, donc, l'essence de la religion. L'argumentation continue en affirmant que le christianisme trouve son aboutissement et son accomplissement dans le protestantisme, qui est donc l'essence du christianisme. On conclut en déclarant que le protestantisme trouve son aboutissement et son accomplissement dans le protestantisme libéral, qui est donc l'essence du protestantisme, et donc du christianisme et par conséquent l'essence de la religion et en fin de compte de l'homme. Le protestant libéral représente, incarne l'humain parfait, absolu. On a là un exemple, un peu caricatural, de démarche idéaliste.
4. De l'absoluité au relativisme.
En 1923 Troeltsch prépare une série de conférences qu'il devait donner à Oxford sous le titre « Le christianisme parmi les religions ». Sa mort subite l'empêcha de les prononcer. Elles ont été publiées par un de ses amis, le baron Von Hügel, grande figure du catholicisme moderniste. Elles témoignent d'une évolution sensible de sa pensée. Troeltsch renonce à son projet primitif d'établir la supériorité du christianisme en montrant qu'il est la religion absolue (au sens que j'ai indiqué) pour trois raisons.
1. En premier lieu, à cause de son caractère trop idéaliste, au sens philosophique de ce mot qui désigne une école de pensée. L'idéalisme, nous venons de le dire, voit dans l'histoire la réalisation et la concrétisation d'idées qui en orientent le cours et en déterminent les figures. L'essence y fonctionne comme une réalité métaphysique ou une puissance ontologique a priori, qui s'incarnerait progressivement dans l'histoire. On écarte ainsi la contingence, la singularité, l'anomalie ; on ignore ou on élimine tout ce qui échappe à l'explication et à la déduction logiques. Troeltsch interprète tout autrement la notion d'essence. Pour lui, elle représente un construction intellectuelle a posteriori, qui exprime la manière dont on analyse et décrit un phénomène, et qui indique la position que l'on prend à son égard, le point de vue que l'on adopte pour l'étudier. Si la notion d'essence, ainsi redéfinie, ne manque ni d'intérêt ni de pertinence, on ne peut toutefois pas s'en servir pour expliquer scientifiquement et pour évaluer objectivement des phénomènes concrets. Elle ne fournit pas une intelligibilité neutre ni des critères universels, c'est-à-dire indépendants du point de vue particulier de l'observateur, de ses propres engagements et prises de positions. Elle ne permet d'échapper ni à la subjectivité ni au parti pris. La détermination de l'essence reflète toujours la situation et les options de celui qui l'opère. Quand on croit fonder sur elle une analyse neutre des faits, et un jugement objectif de valeur, on se trompe. Autrement dit, Troeltsch prend conscience que le concept universel de religion, à partir duquel il voulait montrer l'absoluité du christianisme, n'existe pas.
2. La deuxième raison tient à l'interpénétration et l'interdépendance des phénomènes religieux et culturels, ce qui rend impossible d'isoler une religion de son environnement culturel et social, de la considérer en elle-même pour la comparer avec une autre. Les religions sont hétérogènes et incommensurables, parce qu'elles s'inscrivent chacune dans un contexte différent et en dépendent. Elles n'ont de sens et de valeur qu'à l'intérieur d'une situation donnée. On doit les évaluer en fonction de l'ensemble culturel dont elles font partie et non pas en recourant à une prétendue essence de la religion.
Ce qui conduit logiquement Troeltsch à la conclusion qu'on ne peut pas déclarer le christianisme absolu de manière universelle, mais seulement dans un cadre précis, celui de la culture européenne (qui, selon lui, englobe l'Amérique ; on dirait aujourd'hui plutôt la culture occidentale). Si le christianisme est certainement la religion la meilleure et la plus vraie pour les occidentaux, celle qui leur convient le mieux, il n'en va pas forcément ni vraisemblablement de même pour les chinois, les hindous ou les arabes. Exporter une religion, l'implanter ailleurs que dans son contexte culturel propre n'a donc pas grand sens.
Troeltsch ne souhaite nullement un impossible cloisonnement culturel et religieux. Il ne préconise pas que chacun reste chez soi, cultive son jardin et se désintéresse de l'autre. Il estime qu'il faut entrer dans un échange interreligieux qui admette par principe la diversité et l'altérité sans chercher à les réduire. Les chrétiens doivent reconnaître que les autres religions, je cite, « sont les expressions de la conscience religieuse correspondant à certains types déterminés de culture ». Ces expressions ne sont pas figées, immuables ; elles progressent, s’approfondissent, se purifient, parfois se rectifient. Les contacts avec d’autres religions favorisent ce processus et on doit les encourager, sans pour cela chercher à unifier ou à convertir*. Troeltsch en a tiré les conséquences en présidant une société des missions plus attentive à comprendre les non chrétiens, à dialoguer avec eux qu'à les gagner à l'évangile occidental*.
3. À cette limitation spatiale ou géographique s'ajoute une limitation temporelle ou historique. Elle constitue la troisième raison qui pousse Troeltsch à renoncer à une absoluité universelle du christianisme. En 1900, l'historien Adolf Harnak publie un livre qui a eu un énorme retentissement, L'essence du christianisme. Pour Harnack (du moins l’a-t-on ainsi compris, car en fait sa position est beaucoup plus complexe), on trouve cette essence à la source du christianisme, dans ses origines, autrement dit dans la prédication de Jésus. Elle est donnée au départ et ne se modifie plus. Au contraire, Troeltsch soutient que le christianisme n'a pas une essence fixe et permanente, mais évolutive et changeante. Il ne se définit pas par un ensemble de doctrines, de pratiques et de rites immuables. Il consiste en un processus qui a commencé avant Jésus et se poursuit après lui, même s'il y occupe une place déterminante. Chaque génération de croyants appréhende ou construit à sa manière propre et autrement que les précédentes l'essence du christianisme, sans que l'on puisse trancher entre ces diverses et parfois contradictoires interprétations.
Il en va de même pour la religion. Son essence bouge, se modifie, et, par conséquent, on ne peut jamais parler de religion absolue, c'est-à-dire d'une religion pleinement conforme à son essence. Une religion, cela n'a pas le même sens au huitième siècle avant Jésus-Christ et aux dix-neuvième siècle de notre ère. Ce n'est pas la même chose dans l'Égypte antique et dans l'Amérique contemporaine. Une religion absolue ne peut exister que dans un monde où le temps serait aboli, l'histoire achevée, bref dans le Royaume eschatologique. On ne l'atteint pas tant que les choses bougent, évoluent, et que coule « le fleuve du devenir »*. Les religions historiques n'échappent pas à la relativité, non seulement parce qu'elles ne donnent qu'une connaissance humaine de Dieu (et non la connaissance que Dieu a de lui-même), mais aussi et surtout parce qu'aucune n'accomplit ni n'épuise totalement la connaissance et la conscience que les humains peuvent avoir de Dieu. Il y a toujours place pour une correction et pour un progrès*. Ce qui signifie que nous ne pouvons pas exclure un dépassement et un remplacement du christianisme par une nouvelle religion qui apparaîtrait, conjointement avec une nouvelle culture (la fin du christianisme signifierait la fin de notre culture européenne)..
Troeltsch circonscrit, donc, la prééminence du christianisme dans des frontières spatiales et temporelles étroites. Elle n'a de sens qu'à l'intérieur de notre « horizon du monde », de notre « sphère de vie et de culture »*. Elle vaut pour la période historique que nous vivons, dans le cadre de la culture occidentale à laquelle nous appartenons, et non pour tous les temps et tous les lieux. On ne peut pas l'étendre à toute l'humanité, et encore moins à l'ensemble de la temporalité terrestre (qui dépasse celle de l'humanité), ni à la totalité de l'univers (dont nous avons découvert l'immensité). Entre parenthèses, on trouve des idées très voisines dans la théologie du Process. Troeltsch pose bien une absoluité réelle du christianisme; cependant il la limite géographiquement et historiquement, il la juge provisoire et relative.
5. Un relativisme insatisfait.
Les conclusions auxquelles il aboutit n'enchantent guère Troeltsch. Il aurait préféré, selon son projet initial, avoir réussi à démontrer la supériorité, voire l'excellence du christianisme. Son honnêteté et sa rigueur intellectuelles lui interdisent de tricher et de dissimuler son échec. Toutefois, même s'il estime relatives toutes les convictions humaines, il pense que certaines valent mieux que d'autres et que le christianisme est la meilleure religion. Comment arriver à l'établir solidement? Troeltsch cherche à définir des critères qui permettraient d'apprécier objectivement la valeur des diverses religions. Il n'en trouve pas.
Un temps, il avait pensé pouvoir en dégager trois qui permettraient de montrer la supériorité du christianisme, dans sa version protestante.
Premièrement, un critère éthique, à savoir la capacité d'une religion d'influencer positivement les comportements humains. Le commandement biblique de l'amour du prochain lui semblait répondre de manière indépassable à ce premier critère.
Deuxièmement, un critère spirituel, à savoir la capacité d'une religion de développer des personnalités autonomes et responsables. À cet égard, l'insistance du protestantisme sur la relation individuelle entre l'être humain et Dieu, l'importance donnée à la foi personnelle marquaient un sommet.
Troisièmement, un critère d'universalité, à savoir la capacité d'une religion de synthétiser un grand nombre de valeurs et d'expériences, « de devenir le point de cristallisation de ce qu'on avait découvert de plus élevé et de meilleur dans le monde intérieur de l'homme »*. Le christianisme répond également à ce critère, puisqu'il unit les valeurs mises en avant par les religions de la loi (Judaïsme et Islam), à savoir l'obéissance et la rectitude du comportement, aux valeurs cultivées par les religions de la rédemption (hindouisme et bouddhisme), à savoir la compassion pour les faibles, pour les défaillants, et la volonté de leur offrir des aides et des secours.
Quand il formule pour la première fois ces trois critères, Troeltsch estime qu'ils permettent d'établir de manière suffisante et satisfaisante sinon l'absoluité, du moins la normativité du christianisme, qui apparaît donc comme la religion des religions, celle qui permet d'évaluer les autres. Très vite, Troeltsch se rend compte qu'il s'est laissé piéger et enfermer dans un cercle vicieux. Les critères prétendument objectifs qu'il a définis, outre que leur application n'est pas évidente, découlent en fait du message chrétien, plus précisément du protestantisme et ils posent comme norme ce que justement il s'agit d'évaluer. En les définissant, Troeltsch reconnaît avoir succombé, malgré lui, à l'impérialisme culturel européen. Un bouddhiste poserait des critères très différents. Chaque religion a sa propre normativité et on ne peut pas dégager une normativité universelle applicable à toutes.
En fin de compte, l’affirmation de la supériorité du christianisme relève d’une conviction personnelle, qu’on ne peut pas démontrer ni justifier. Elle découle d'un acte de foi et ne peut prétendre à une validité autre qu'existentielle et subjective. Je peux dire que l'évangile est pour moi la révélation absolue, que le christianisme est pour moi la religion absolue ; je ne peux pas en conclure qu'il en va de même pour tous les humains. L'absolu prend pour eux des formes différentes entre lesquelles rien ne permet de trancher. Dans ses conférences de 1923, que la mort l’a empêché de prononcer, Troeltsch déclare que toutes les religions prennent leur source dans l’Esprit divin et ont la même visée, l’union avec cet Esprit. Les chemins qui vont de la source à l’objectif sont multiples et divers. « Entre ces deux pôles, dit Troeltsch, se trouvent toutes les différences individuelles de race et de civilisation qui entraînent l’immense variété des religions … Aussi loin, continue-t-il, que le regard humain peut pénétrer dans l’avenir, il semble probable que les grandes religions liées aux différentes civilisations resteront distinctes … et que la question de leur valeur relative ne pourra jamais recevoir une réponse objective »*.
Conclusion
Les conférences de 1923 se terminent donc par l'impossibilité de déclarer une religion meilleure que les autres. Chacune a sa vérité dans son propre contexte (ce que Von Hügel qualifiera de vérité-cameléon, en ce sens qu'elle se modifie en fonction de l'environnement). Le problème reste donc entier, et Troeltsch meurt sans avoir trouvé la solution qu'il cherchait et sans être sûr qu'il y ait une solution.
Je fais deux remarques sur cette réflexion de Troeltsch.
1. Les relativistes que l'on rencontre dans la rue, dans les discussions de salon ou dans les réunions de paroisse se montrent, en général, assez fiers, et assez satisfaits d'eux-mêmes. Ils s'estiment parvenus à un haut niveau de largeur de vue et de grandeur d'esprit. Au contraire, Troeltsch aboutit à un relativisme insatisfait, mécontent de lui-même qui a conscience d'un échec, peut-être inévitable, de la pensée, d'une ignorance regrettable, même si elle paraît invincible.
2. Le relativisme de Troeltsch a une dimension plus externe qu'interne. Je veux dire par là qu'il n'incite pas les croyants à minimiser ou à relativiser leur propre religion. Chacune a une valeur absolue pour celui qui lui appartient. Par contre, ce qui vaut pour moi ne s'applique pas forcément aux autres et je ne peux pas le généraliser, l'universaliser, l'imposer à tous. Le Christ est véritablement le seigneur et le sauveur du chrétien. Je ne peux pas en déduire qu'il n'y a pas d'autres seigneurs et sauveurs tout aussi véritables pour d'autres êtres humains.
2. George Lindbeck
Comme second exemple d'une position relativiste qui compartimente les religions, j'ai choisi un contemporain George Lindbeck. J'ai un peu hésité, et je me suis demandé un moment si je n'allais pas plutôt retenir un hindou chrétien, Stanley Samartha, né en 1920, qui a joué un rôle important au Conseil Œcuménique des Églises, il y une trentaine d'années. Il y dirigeait le département intitulé Dialogue avec les gens se rattachant à des fois ou des idéologies vivantes (un titre un peu compliqué). J'aurais été assez content d'introduire un non occidental parmi les théologiens étudiés. Je ne l'ai pas fait parce que la pensée de Lindbeck me semble avoir une tout autre envergure que celle de Samartha, Je ne crois pas que ce jugement relève d'un impérialisme occidental. Même si son œuvre ne manque pas d'intérêt, si elle a l'avantage de joindre relativisme et ferveur religieuse, elle reste le plus souvent rapide et superficielle. À mon sens, Lindbeck a plus à apporter, ce qui a déterminé mon choix.
1. Présentation
1. George Lindbeck est né en 1924 en Chine qu’il quitte à l’âge de dix-huit ans. Il a vécu les premières années de sa vie dans un pays où les chrétiens ne représentaient qu’une infime minorité et où d’autres religions dominaient. Après des études aux États-Unis et en Europe, il a enseigne longtemps, jusqu'à sa retraite, l'histoire de la théologie et de la philosophie à la prestigieuse Université de Yale, dans le Connecticut, entre Boston et New-York. Bon spécialiste de l'histoire des idées, il a écrit plusieurs ouvrages remarqués dans ce domaine.
En 1984, il publie un petit livre de 140 pages, intitulé La nature des doctrines qu’on a traduit, vingt ans après sa publication, en français. Cet ouvrage relativement bref, mais subtil, a eu un très grand retentissement. Une discussion fournie s'engage autour de ses thèses et il devient une référence incontournable. La critique américaine le classe, peut-être un peu rapidement, parmi les textes qui marquent un tournant dans la réflexion théologique.
Ce livre part des difficultés actuelles du dialogue œcuménique entre les Églises chrétiennes et s'interroge sur la manière dont il peut se poursuivre et avancer. Lindbeck y réfléchit à partir et en fonction des débats et échanges interconfessionnels qui se poursuivent depuis un demi-siècle. Il en a une importante expérience. Il a participé en tant qu'observateur protestant au Concile de Vatican 2 et la Fédération luthérienne mondiale a fait souvent appel à lui pour la représenter dans des entretiens multilatéraux. Lindbeck, malgré son passé chinois, n'a pas une pratique aussi forte des rencontres interreligieuses. Toutefois, il note que dans les deux cas, on rencontre des situations voisines et qu'on se heurte à des obstacles analogues. Le dialogue avec des fidèles d'autres religions soulève des problèmes proches de ceux qui se posent dans les discussions entre chrétiens de diverses confessions. Il n'y a sans doute pas tout à fait identité, mais, en tout cas, une forte similitude. Lindbeck estime, par conséquent, que ses analyses et ses thèses concernent tout autant l'interreligeux que l'interconfessionnel.
2. La réflexion de Lindbeck doit beaucoup à la manière dont à l'Université de Yale, où il enseigne, on comprend et on pratique l'enseignement des religions. De même que Troeltsch est « le dogmaticien de l’école de l’histoire des religions, Lindbeck est le dogmaticien de l’école de Yale. Cette école originale est le berceau de l’exegèse canonique (avec Brevard Childs) et de la théologie de la narrativité avec Hanz Frei. S’y rattache également David Kesley qui s’intéresse à la manière dont les textes canoniques fonctionnent et structurent des communautés. Dans sa réflexion, Lindbeck reprend et utilise ces diverses études et orientations.
En ce qui concerne les religions, je vous l’ai signalé dans mon premier cours, cette école ou cette mouvance insiste beaucoup sur les différences entre les religions et sur la singularité de chacune d'elles. L'université de Yale s'oppose sur ce point à celle de Chicago. À Chicago, sous l'influence de Mircéa Eliade, on a tendance à voir dans les diverses religions de l'humanité les formes multiples d'un seul et même phénomène. On considère volontiers que les symboles, rites, pratiques et doctrines, si divers soient-ils, renvoient à une expérience universelle du sacré, commune à tous les humains. Ainsi, les travaux d'Eliade ne portent pas sur telle ou telle religion, mais sur des thèmes qu'il étudie de manière transversale, comparative en cherchant à dégager des structures communes dans des religions diverses (par exemple, le mythe, le sacré et le profane, la prière, l'expérience de la temporalité, etc.).
Au contraire, à Yale, on met à part, on isole chaque religion. On la situe dans son contexte historique et culturel propre. On la considère comme foncièrement différente des autres. On estime que chacune d'elle forme un ensemble cohérent où chaque point se tient et prend sens en fonction des autres. On n'enseigne pas l'histoire ou la science de la religion, mais soit le judaïsme, soit le bouddhisme, soit l'islam, sans chercher à établir de rapprochements que l'on juge dangereux, parce qu'ils risquent d'égarer. Au fond, thèse soutenue par le canadien Cantwell Smith, les diverses religions n'ont en commun que le nom dont on se sert pour les désigner. Tout les distingue, tout les sépare. C'est arbitrairement et artificiellement qu'on les range sous la même étiquette. De même, on appelle « chien » un animal domestique, une pièce d'arme à feu, une tenaille utilisée en métallurgie et une constellation d'étoiles. Ces divers chiens n'ont rien de commun, sinon un nom. Il serait absurde et égarant de prévoir une « science des chiens » qui étudierait ensemble des objets aussi différents que rien, sinon un mot, ne rapproche. Il en va de même pour l'histoire des religions. Lindbeck ne va pas jusque là et ne se montre pas aussi radical. S'il souligne la diversité foncière des religions, il leur reconnaît également des traits communs. En particulier, elles proposent toutes des doctrines, des rites, des pratiques, qui expriment, dans des registres différents, la religion ; elles se présentent donc toutes comme des discours religieux adressés soit à leurs fidèles, à ceux qui y adhèrent, soit aux non fidèles, c’est-à-dire aux gens du dehors, à ceux qui ne se rallient pas à la religion qui s’y exprime.
2. Prémodernité et modernité religieuses
Le dialogue interconfessionnel et interreligieux consiste principalement à comparer et à confronter des discours religieux différents. On s'occupe beaucoup de leurs contenus : peuvent-ils se concilier et se combiner, ou, au contraire, présentent-ils des incompatibilités qui les rendent inconciliables ? Disent-ils la même chose ou des choses contradictoires ? Par contre, on ne s'interroge guère sur la nature et la visée des discours religieux ; on ne se demande pas assez comment ils parlent, ce qu'ils entendent dire, quelle fonction il remplissent, quelle sorte de langage ils utilisent, comme si tout cela allait de soi et ne posait aucun problème. Lindbeck pense qu'on à tort, et qu'il faut réfléchir en priorité, avant toutes choses, au statut du discours religieux. Il distingue et oppose deux manières de le concevoir qui sont courantes mais insuffisantes et qu’il rejette l’une et l’autre.
1. Il y a, en premier lieu, le modèle ou le type qu'il appelle « cognitif-propositionnel », et qu'il qualifie de « prémoderne ». On le rencontre dans les orthodoxies classiques, et dans les courants plus récents qu'on qualifie dans le monde anglo-saxon de fondationnalistes ou de propositionnalistes.
Pour ce modèle, la religion formule des doctrines qui ont pour fonction de fournir des informations et de donner des connaissances. Elles apprennent ce qu'est (ou qui est) Dieu, elles définissent ce qu'est (ou qui est) l'homme, elles enseignent des vérités sur le monde, elle disent en quoi consiste le salut. Les religions apportent ainsi un savoir sur des objets naturels ou surnaturels. Elles énoncent des propositions qui décrivent l'être de Dieu, celui du monde et celui de l'humanité, qui les reflètent comme un miroir. Quand la religion en donne une image exacte, elle est vraie. Lorsqu'elle déforme, brouille et donne une image trouble ou inexacte, elle est fausse. La concordance de ce qu'elle dit avec la réalité factuelle de la transcendance détermine la vérité d'une religion.
Ce modèle, qui correspond assez exactement à ce que Troeltsch appelle la démarche dogmatique, repose sur un positivisme naïf. Dans les rencontres interconfessionnelles et interreligieuses, il enferme dans une impasse. Il présente trois grands défauts.
D’abord, il implique qu’il y a un seul discours vrai, celui qui se conforme aux choses et qui les décrit exactement. Là où les discours divergent, forcément l’un est juste et les autres erronés. Il n'y a pas de compromis, d'évolutions, de rapprochements possibles entre les interlocuteurs, sauf quand le désaccord repose sur un malentendu. Si tel n'est pas le cas, pour s'entendre, il faut qu'un des camps capitule, abandonne ses positions, se rende ou se rallie à celles de l'autre. Le dialogue vise donc la conversion du partenaire à ses propres thèses et convictions. On ne sort donc pas de positions et d’attitudes exclusivistes.
En deuxième lieu, l’épistémologie contemporaine (autrement dit la réflexion actuelle sur le savoir) le dément, le rend caduc et inoutenable. Plus personne en philosophie et en sciences ne définit la vérité par la correspondance du discours avec le réel ni ne croit en la possibilité d'une connaissance objective, valable par son contenu, indépendamment de la position du sujet connaissant. Vous connaissez peut-être la distinction, qu’on rencontre aujourd’hui chez beaucoup de psychanalystes, de physiciens, d’historiens et de philosophes entre le réel et la réalité, qui reprend la problématique kantienne du noumène et le phénomène. Le réel est la chose en soi telle qu’elle est en elle-même ; nous n’y avons pas accès, elle nous échappe. La réalité est la chose telle qu’elle nous apparaît, telle que nous la percevons à travers les lunettes déformantes de nos organes de perception, de nos catégories de pensée, des concepts et des mots de notre langage. Alors que l’épistémologie moderne souligne fortement que la réalité ne coïncide jamais avec le réel, au contraire le modèle cognitif propositionnel implique une équivalence. Il est à cet égard prémoderne et inadapté à la culture contemporaine.
Enfin, troisième défaut, l'histoire de la pensée religieuse (que Lindbeck, je le rappelle, a enseignée à Yale) contredit, dément et réfute ce modèle. En racontant comment se sont formées les doctrines et développés les rites des religions, elle montre que de multiples facteurs, politiques, psychologiques, culturels ont joué. Tout autant sinon plus que l’être ou le réel divin, la religion reflète la situation intellectuelle, spirituelle et matérielle d'une époque.
2. On trouve une deuxième conception de la religion ou du discours religieux, que Lindbeck appelle « expérientielle-expressiviste ». Ce second modèle, avancé, défendu, développé par la théologie libérale des dix-neuvième et vingtième siècles, caractérise la modernité. Il considère que la religion exprime des sentiments intérieurs, traduit des états d’âme, reflète une expérience spirituelle. La doctrine ne définit pas ce que Dieu est en lui-même ; elle dit de quelle manière nous le percevons, le sentons ou l'expérimentons, comment il marque notre vie personnelle et communautaire. Le discours religieux ne se réfère donc pas tant à l'objet dont il parle qu'au sujet (singulier ou pluriel) qui parle. Il ne fournit pas un savoir, il témoigne (de manière réfléchie) de ce que vit et sent une communauté croyante. Nous rejoignons ici l'affirmation de Troeltsch que la théologie doit renoncer à la « dogmatique » (avec sa prétention à une objectivité universelle) pour devenir une « doctrine de la foi » qui reconnaît sa subjectivité et sa relativité.
Cette deuxième conception de la religion permet de conjuguer le respect de la pluralité avec la recherche de l'unité. La vérité, une en son essence, se manifeste de manière polymorphe. En effet, d'une part, la forme de l'expérience spirituelle varie selon les contextes culturels et historiques, d'où une diversité légitime de nos expressions doctrinales. Pourtant, d'autre part, la substance ou le contenu de cette expérience tient à la structure ontologique humaine commune à tous. Cette structure a un caractère universel. Elle ne varie pas selon les époques et les lieux. Elle ne dépend ni du contexte, ni de la culture. Au travers et en dépit de sa diversité, l'humanité présente une unité fondamentale. Dans son essence ou dans son noyau prélinguistique, antérieur au discours qui veut l'exprimer aux doctrines et aux rites qui la traduisent ou la concrétisent, l'expérience religieuse est partout la même. Ainsi un bouddhiste et un chrétien peuvent avoir exactement la même foi fondamentale, la même expérience spirituelle et l’exprimer en des termes totalement autres. Les dialogues interconfessionnels et interreligieux se donnent alors pour objectif de remonter à travers les divers langages doctrinaux, liturgiques, rituels et éthiques jusqu'à l'expérience originelle et fondatrice, identique pour tous. On s’efforce à partir et au travers de ce qui est dit de découvrir ce que cela veut dire, d’aller depuis le discours jusqu’à l’expérience qui s’y exprime. Il s'agit précisément de la démarche que les tendances dominantes à l'Université de Yale critiquent et refusent.
Selon Lindbeck, très représentatif de Yale sur ce point, le modèle expérientiel-expressiviste conduit à une impasse et aboutit à un échec. Quand on essaie de remonter, au-delà du langage, à une expérience pure parce que non dite, non exprimée, on poursuit une chimère. En effet, le langage façonne, structure toutes nos expériences spirituelles. Il les fait naître, il les provoque et les suscite, il les constitue. Il ne les suit pas ; il ne vient pas en second lieu, dans un deuxième temps pour interpréter une réalité antérieure. Il n’exprime pas la subjectivité des individus, il la modèle. Les émotions n’engendrent pas des paroles, mais les paroles font naître, suscitent des émotions. Ainsi le langage amoureux fait surgir, façonne, structure l’amour ; sans les poètes et les romans nous n’éprouverions pas ou, en tout cas, nous ne vivrions pas de la même manière l’amour. De même, il n'existe pas de sentiment religieux indépendant du langage. Ce n’est la conscience du sacré qui génère le discours religieux, mais le discours religieux qui génère et façonne la conscience du sacré. Sans langage, on ne peut pas avoir cette conscience, on ne peut pas vivre ou éprouver le sentiment d’une présence transcendante. Les auteurs du Nouveau Testament le disent à leur manière. « La foi vient de ce que l'on entend », déclare l'apôtre Paul, et Jean écrit : « Au commencement, il y a la parole ». Ces textes posent une primauté ou une antécédence du discours. Pour prendre un exemple historique bien connu, selon Lindbeck, ce n’est pas l’expérience de la tour qui conduit Luther à la doctrine de la justification par la grâce, mais la découverte dans l’épître aux romains de la doctrine de la justification par grâce qui provoque ou en tout cas rend possible l’expérience de la tour.
Il ne faut évidemment pas caricaturer ou simplifier à l’excès. Lindbeck souligne qu’en fait il se produit un aller-retour, que la relation est dialectique : le langage génère des sentiments, des émotions, une expérience qui en retour viennent moduler, enrichir et modifier le langage. Ce qu’on peut représenter par le schéma suivant :
Le modèle expérientel-expressiviste présente cet autre schéma, au fond, assez voisin :
On peut adresser au modèle expérientel expressiviste une deuxième critique : il pose ou suppose très souvent (mais pas obligatoirement ni toujours) une unité fondamentale des expériences religieuses. Cette hypothèse résiste mal à l'examen, les analyses ne la vérifient pas, elles renvoient plutôt à une irréductible diversité. Elle n'a pas grande efficacité opératoire dans les dialogues ; elle les égare dans la quête illusoire d'une origine ou d'une source pure.
3. Postmodernité et jeux de langage
Lindbeck juge insuffisantes et insatisfaisantes ces deux manières de concevoir la religion, aussi bien la première qui domine à l'époque prémoderne, que la seconde qui caractérise la modernité. Il va donc élaborer un troisième type ou modèle, qu'il qualifie de « postlibéral », mot équivalent pour lui à « postmoderne » (il identifie, en effet, libéralisme et modernité). Ce modèle voit dans la religion non pas l'expression de ce qu'est Dieu (premier modèle) ni l'expression de ce que vit le croyant (deuxième modèle), mais un langage ou plus exactement un système linguistico-culturel. Autrement dit, une religion constitue un jeu de langage, constitué par un lexique et une syntaxe. Pour expliquer cette définition, nous allons nous arrêter d'abord sur le lexique et le vocabulaire, ensuite sur le jeu de langage.
a/ Lexique et syntaxe. Lindbeck propose d'assimiler chaque religion ou chaque confession à une langue, telle que le français, l'anglais ou l'allemand. Toute langue comporte deux éléments qui la constituent et la définissent : un vocabulaire et une grammaire.
La théologie ou la doctrine fonctionne, d'abord, comme le dictionnaire qui dresse la liste de mots et de concepts qu'utilise une religion ou une confession et qui en indique le sens. Elle en formule, ensuite, la grammaire. Elle pose les principes qui déterminent le fonctionnement du vocabulaire, qui disent comment les mots et les concepts peuvent s'articuler les uns avec les autres pour former un discours.
Pour prendre une autre image, on pourrait comparer une religion et une langue au football. Pour que le match puisse s'engager et se dérouler, il faut, d'une part, réunir des objets et des êtres (ballon, terrain, buts, joueurs, arbitres, etc.) que l'on peut énumérer dans un inventaire (l'équivalent, ici, du dictionnaire). D'autre part, on a besoin des règles, formulées dans un code ou une loi, qui indiquent les évolutions permises, les mouvements interdits, la durée des mi-temps et des pauses, etc. (ce qui correspond à la grammaire).
Ces comparaisons n'entendent pas du tout dévaloriser ou déprécier la religion et diminuer la valeur ou la portée de la théologie, bien au contraire. Le football joue un rôle considérable dans notre société ; on ne peut pas le réduire à un simple divertissement. La langue que nous parlons construit notre personnalité. Elle façonne notre réflexion et notre sensibilité. Elle détermine une certaine manière de comprendre l'existence et le monde. Elle permet de communiquer et d'échanger. Elle médiatise et rend possible une relation avec la réalité et avec les autres. Il ne faut pas en sous-estimer l'importance. Ainsi une langue qui privilégie les substantifs, comme le français ou qui au contraire donne une place primordiale aux verbes, tel l’anglais, génèrent des comportements différents et favorisent des visions du monde qui ne sont pas du tout les mêmes. Une langue analytique qui pousse à séparer et à isoler les divers éléments de l’expérience et une langue holistique qui tend au contraire à les réunir entraînent des attitudes et des philosophies divergentes.
b/ Les jeux de langage. Lexique et grammaire définissent ce qu'on appelle, selon une expression empruntée à Wittgenstein, un « jeu de langage ». Chaque religion et chaque tradition confessionnelle constitue et représente un jeu différent de langage. Les groupes religieux se caractérisent par un idiome, un patois ou un dialecte, qui leur est propre, et dont leur doctrine définit le vocabulaire et la grammaire.
Dans les dialogues œcuméniques entre Églises, on constate deux choses. D'abord, que tous les chrétiens ont en commun d'utiliser la Bible comme le lexique ou le dictionnaire qui fournit des mots, des concepts et des symboles. Ensuite, que chaque confession, le catholicisme, le luthéranisme, le courant réformé, l'orthodoxie a sa grammaire particulière, c'est-à-dire sa manière propre de faire fonctionner ces notions et thèmes. Les chrétiens se ressemblent parce qu'ils emploient le même vocabulaire et ils se divisent parce qu'ils utilisent des syntaxes différentes. Pour prendre un exemple classique, donné par Schleiermacher dans le § 24 de La foi chrétienne, catholicisme et protestantisme se distinguent par la manière dont ils conçoivent le lien entre le fidèle, l’église et le Christ. Pour le catholicisme, le lien du fidèle avec le Christ se fait par l’intermédiaire de l’église ; c’est l’appartenance du croyant à l’église qui détermine sa relation avec le Christ, ce qui donne le schéma suivant :
CHRIST ---à ÉGLISE ---à FIDÈLE.
Pour le protestant, c’est le lien qui s’établit entre le Christ et le fidèle qui conduit ce dernier à devenir membre de la communauté chrétienne ; c’est sa foi, sa relation personnelle avec le Christ qui détermine son appartenance à l’Eglise ; d’où le schéma :
CHRIST ---à FIDÈLE --à ÉGLISE
Dans les deux cas, nous trouvons les mêmes réalités (Christ, fidèle, église) ; protestants et catholiques ont un vocabulaire commun. Ils se distinguent en ce qu’ils ne les articulent pas de la même manière : ils ont une syntaxe différente. Par contre, dans les rencontres interreligieuses, les participants parlent des langues totalement étrangères les unes aux autres ; elles se distinguent à la fois par leur vocabulaire et leur grammaire.
Cette compréhension des religions comme des jeux de langage ou comme des systèmes linguistico-culturels différents a trois conséquences, que Lindbeck ne tire pas lui-même. Ce sont même des conséquences qu’il préférerait éviter, mais que d’autres que lui pourraient adopter à partir de ses analyses.
1. D'abord, chaque religion forme un ensemble, un système où tout se tient. On ne peut pas isoler un élément, pour l'étudier et le traiter séparément. Ainsi, dans les dialogues entre chrétiens de confessions différentes, on perd son temps quand on travaille sur des points particuliers, le baptême, la cène et les ministères, par exemple. C'est comme si on avait une partie de cartes, où deux partenaires jouent au bridge et deux autres à la belote, et qu'on se mette à discuter de la figure du roi de pique ou de la dame de cœur. Quand on aura décidé que le premier est barbu et la seconde blonde, on n'aura nullement avancé, car le problème ne porte pas sur les figures (le vocabulaire) mais sur les règles du jeu (la grammaire). De même, la signification d'une doctrine particulière tient moins à son contenu qu'à la manière dont elle se relie aux autres, et fonctionne dans le système global. Ainsi la conception chrétienne de la prière a du sens à l'intérieur de la doctrine et de la piété du christianisme ; si on la transpose dans l'Islam, elle devient incompréhensible et absurde.
2. Ensuite, les échanges ou les emprunts entre religions deviennent illusoires. Les pratiques et les doctrines de l’une ne peuvent pas se transmettre ou émigrer à l’extérieur ; quand cela se produit, c’est aux prix de changements tels que ce ne sont plus les mêmes pratiques et doctrines. Lorsque des chrétiens s’adonnent à la méditation transcendantale, ils peuvent bien penser qu’ils s’inspirent du bouddhisme zen ; en réalité ils font tout autre chose. Personne n'envisage de faire fonctionner les mots français selon la grammaire japonaise, ni de se servir de la grammaire française pour construire des phrases en hébreu, pas plus que l'on ne pourrait appliquer les règles du tennis à un match de rugby. Une grammaire et un vocabulaire ne s'exportent pas ni ne se dissocient. Ils fonctionnent ensemble à l'intérieur de leur zone de pertinence. Ceux qui joignent des éléments du bouddhisme avec d’autre venus de l’islam et avec d’autres encore d’origine catholique (ce qu’on a appelle parfois la spiritualité de supermarché), en fait dénaturent complètement les éléments qu’ils reprennent. Ils ne mélangent pas ni ne mettent en relation des religions existantes ; ils créent une autre religion sans aucun rapport avec les existantes. C’est comme s’ils inventaient un nouveau langage, ce qui d’ailleurs en général ne marche pas.
3. Troisième conséquence, comparer entre elles les religions, tenter de les évaluer les unes par rapport aux autres n’a dans cette perspective pas de sens. Dans la démarche propositionnelle-cognitive, on peut chercher à déterminer quel discours rend le mieux compte de Dieu et de son action ou de sa présence parmi les humains. Dans la démarche expérientelle-expressive, on peut tenter de discerner quel discours traduit le plus justement l’expérience spirituelle humaine. Dans les deux cas, un référent permet de mesurer en principe la validité du discours. Par contre, pour la démarche linguistico-culturelle, apprécier la vérité d’un discours religieux n’a aucun sens. Qu’est ce qui permet de dire que l’italien est une langue plus vraie que l’espagnol, que l‘anglais est plus juste que l’allemand, que le hongrois est supérieur au danois ? De même les religions sont différentes, mais elles ne sont ni justes ni fausses, ni plus ou moins vraies.
4. Référent et intratextualité
À partir des analyses que nous venons de voir, on peut distinguer trois sortes de langage, ou trois catégories de discours.
- D'abord, le langage descriptif ou discours énonciatif, qui dit ce que sont les choses. L’époque classique ou prémoderne a compris sur ce modèle la religion.
- Ensuite, le langage affectif ou discours expressif qui traduit une expérience. La modernité a interprété de cette manière la religion.
- Enfin, le langage performatif ou discours opérant. Il fournit les mots et les règles qui permettent de communiquer, d'organiser la vie de la communauté et de structurer celle des individus. Les religions, comprises par la postmodernité comme jeu de langage constitué par un vocabulaire et une grammaire, appartiennent à cette troisième catégorie, celle des discours qui n'entendent pas traduire quelque chose d'autre, mais structurer la communication et l'existence humaines.
Pour Lindbeck, la religion ne renvoie donc pas à une réalité ou à une vérité qui lui serait extérieure et hétérogène. Elle n'exprime pas une expérience intérieure qui la précéderait. Elle ne parle pas de Dieu tel qu'il est en soi. Elle dit seulement comment il fonctionne parmi nous. Lindbeck, de même que Troeltsch, ne nie nullement qu'il y ait une transcendance. Il y croit fermement. Il estime seulement qu'on ne peut pas se référer à ce qui dépasse le langage. Nous sommes enfermés dans le discours qui structure et façonne notre existence. Nous ne pouvons rien percevoir au-delà. Comme l'écrit le philosophe Jacques Derrida, « il n'y a pas de hors texte » auquel le texte renverrait et qui permettrait de le jauger, de l'évaluer.
La religion est le langage auquel le croyant se réfère, mais qui n'a pas lui-même de référent ; elle est le discours qui organise l'existence, mais que rien n'organise. Ou, plus exactement, s'il y a un référent et un principe organisateur du langage, s'il y a un hors-texte, nous n'en savons rien, et nous ne disposons d'aucun moyen pour le découvrir. Il nous échappe nécessairement. Il relève de ce que Calvin appelait « le secret » de Dieu. Pour notre part, nous ne sortons jamais du langage. Aucun chemin, aucune méthode, rationnelle ou intuitive, logique ou mystique ne nous permet d'aller en deçà vers ce qui lui donne naissance, ou au-delà vers ce qu'il vise.
S'il n'y a pas de référent accessible, il s'ensuit que notre vérité, celle dont nous vivons et que nous affirmons, est intra textuelle, interne au texte, que ce soit ce texte soit celui de la Bible ou celui d'autres discours religieux. La vérité ne se trouve pas ailleurs que dans le discours ; elle ne se situe pas dans ce à quoi il renvoie, dans son rapport avec une réalité externe. On rejoint ici le thème de la narrativité développé par un autre professeur de Yale, Hans Frei. La narrativité situe la vérité ou le sens d'un texte non pas en dehors, mais en dedans de lui. Pour l'exégèse moderne, qui se développe à partir du dix-septième siècle, le discours renvoie à un monde qui lui est extérieur et elle s'efforce de dégager, d'élucider le rapport entre ce qui est dit ou écrit avec ce monde. Au contraire, pour le christianisme ancien et moyenâgeux, que rejoint la postmodernité sur ce point, le livre ne parle pas du monde, il est le monde, il le constitue. Le récit ne renvoie pas à un événement, il est l'événement, il s'identifie avec ce qu'il raconte. L'exégèse moderne cherche à partir de ce que dit le texte ce qu'il veut dire. Elle essaie de dégager la vérité qu'il entendrait traduire. Elle n'aboutit jamais, elle ne trouve jamais rien, parce qu'elle poursuit une chimère. Pour le postmoderne, le sens d'un récit ne se trouve pas ailleurs, dans une réalité dont le texte parlerait. Il se confond avec le récit, ou plus exactement avec le fait de raconter, avec la narration. Au lieu d'expliquer, de commenter, d'analyser, racontez et écoutez. Le christianisme est une histoire, non une exégèse. En reprenant, et en en modifiant légèrement le sens, une expression du philosophe Jean-François Lyotard, les religions sont toutes des « métarécits », c'est à dire de grandes histoires, des contes fondateurs qui structurent des individus et des communautés, sans que rien ne puisse venir donner sens à ces métarécits. On peut entrer dans ce qu'ils racontent et en bénéficier ; on ne peut pas se situer à l'extérieur, en dehors d'eux pour les évaluer.
De même, pour Lindbeck, la vérité d'une religion se trouve en elle-même et s'exprime dans la manière dont elle fonctionne, ou dont elle fait fonctionner une communauté. Les religions, écrit-il, « énoncent des vérités intrasystémiques, plutôt qu'ontologiques », autrement dit, elles régulent des jeux de langages spécifiques et ne renvoient pas à des réalités qui lui seraient extérieures. Il en résulte qu'on perd son temps quand on se préoccupe de l'exactitude des doctrines, religieuses, quand on se soucie de leur juste formulation, quand on s'interroge sur ce dont elles parlent. On ferait mieux d'essayer de voir comment elles fonctionnent, de chercher à percevoir la cohérence et la logique qu'elles génèrent. On peut parvenir à comprendre la langue de l'autre; on n'arrivera jamais à une langue universelle, ou à réunir et fusionner deux langues en une seule. Si je reprends l'image du jeu, les uns pratiquent le bridge, les autres les échecs. Je ne peux ni comparer ni mélange ni rapprocher bridge et échecs. Par contre le bridgeur peut essayer de comprendre le jeu d'échec et le joueur d'échecs le bridge. Les religions sont irréductibles les unes et les autres ; elles ne se laissent pas ramener à l'unité. Ce que les rencontres interreligieuses peuvent espérer obtenir, et ce n'est pas négligeable, c'est une compréhension mutuelle entre les divers croyants, ce qui favorisera de bons rapports humains
Conclusion
Je conclus par trois remarques.
a/ Culture et religion. Lindbeck reprend la question de la nature ou de l'essence de la religion posée par les protestants libéraux du dix-neuvième siècle, mais il le fait dans un contexte et avec des préoccupations autres. Alors que le libéralisme la posait à partir d'une confrontation avec la science et la culture, Lindbeck y réfléchit de l'intérieur d'une situation typiquement religieuse, en fonction des problèmes et des enjeux posés par la multiplicité des églises et des obédiences religieuses.
À la question de l'essence de la religion, les libéraux du dix-neuvième siècle ont cherché à donner une réponse foncièrement théologique. Ils ont tenté de trouver une solution en réfléchissant sur la foi, sur sa manière de se référer à Dieu et de l'exprimer, sur les conditions d'un discours qui parle authentiquement de Dieu. Au contraire, Lindbeck va recourir aux théories linguistiques et sociales et mener une réflexion qui reprend et utilise des démarches et des travaux en philosophie et en sciences sociales.
Lindbeck opère donc une sorte de renversement par rapport à la théologie libérale. Cette dernière pose la question de l'essence de la religion principalement à cause de ce qui se passe dans la culture laïque, profane ou séculière et elle y répond par un discours théologique, la religion faisant effort pour se penser et s'exprimer mieux ou autrement qu'elle ne l'avait fait jusque là. Lindbeck pose la question de la nature de la religion à cause des dialogues que les religions mènent entre elles et il cherche dans la culture des éléments qui lui permettent d'y répondre. Chez les libéraux, la situation culturelle constitue la question à laquelle la théologie doit chercher une réponse. Chez Lindbeck la situation théologique constitue le problème que des éléments culturels vont aider à résoudre. Il tente d'apporter une solution laïque à un problème religieux.
b/ Un relativisme conservateur et autoritaire. Le relativisme de Lindbeck risque de déboucher, en fin de compte, sur des positions conservatrices et autoritaires et ne favorise guère des évolutions ou des modifications dans les doctrines et pratiques religieuses. Lindbeck reconnaît que les règles du jeu définies par chaque religion sont arbitraires et impossibles à justifier. Pourtant, il n'admet guère, précisément parce qu'elles relèvent d'une convention constitutive, qu'on les discute et qu'on les conteste. Il accepte qu’on puisse leur apporter des aménagements minimes qui ne dérangent pas voire qui renforcent la logique générale, mais pas de bouleversements. Si les règles du rugby ne vous conviennent pas, allez jouer au tennis, mais ne cherchez pas évaluer ou à modifier ces règles, ce qui supposerait d'avoir recours à un référent extérieur à l'univers qu'elles constituent*. Lindbeck se montre à la fois plus relativiste et plus répressif que le libéralisme. Plus relativiste parce qu'il supprime la référence à une transcendance que le libéralisme maintenait. Plus répressif car il élimine toute instance critique qui autoriserait à discuter, à contester, et qui permettrait d'aller plus loin. La religion système linguistique menace de se refermer sur le croyant comme une prison dont il ne peut pas s'échapper. Il n'a pas d'autre solution que d'obéir et de se taire, ou de s'en aller ailleurs où il devra aussi se soumettre. De plus, Lindbeck n'enferme-t-il pas chaque religion dans sa logique propre, sans lui donner les moyens de se reformer, de progresser et de se rapprocher des autres?
c/ Le modèle linguistique, solution ou impasse? Il y a quelque chose de paradoxal et de contradictoire dans la réflexion de Lindbeck. On a le sentiment que, comme c'était le cas pour Troeltsch, elle l'entraîne là où il ne veut pas aller. Il y a contradiction entrer ses intentions et ses résultats, entre ce qu’il cherche et ce vers quoi il oriente. Le but atteint diffère fortement de l'objectif visé. Son entreprise part du désir de faire avancer les dialogues aussi bien œcuméniques qu'interreligieux. Elle se veut à la gloire de Dieu. Et elle conduit à un scepticisme à la Montaigne (« je suis la religion de mon pays parce que c'est pour moi plus commode »), et à un relativisme radical (« toutes les religions sont bonnes du moment qu'elles sont adaptées à leur contexte »). Lindbeck le reconnaît en partie. Il déclare que la discussion autour de son livre l’a amené à le comprendre autrement. J’ai signalé à plusieurs reprises que la théorie de Lindbeck entraînait des conséquences qu’il n’approuvait pas. Entre ce que l’auteur a voulu dire et faire et la signification de son œuvre, il n’y a pas coïncidence mais décalage, voire opposition. Loin de faciliter la rencontre entre religions, ce qui est son intention, l’analyse de Lindbeck la rend sinon impossible du moins limitée. Elle permet une coexistence et une juxtaposition pacifiques mais interdit d’aller plus loin.
Conclusion
Souvent, les propos relativistes ne vont pas très loin et traduisent surtout une absence de réflexion et une indifférence aux questions religieuses.
Avec Troeltsch et Lindbeck, on a, au contraire, les éléments pour un relativisme pensé qui arrive à l'aboutissement de tout un processus de réflexion, et qui n'a rien de confortable ni de paresseux. Ces deux théologiens ne l'ont pas cherché ; il s'impose à eux, malgré leur désir, en dépit de leur conviction. Il les laisse insatisfaits, on ne voit pas comment ils pourraient le dépasser. Ils s’efforcent de ne pas être relativistes et ne seraient pas très heureux qu’on considère qu’ils conduisent à un compartimentage ou à une juxtaposition des religions. Leur démarche mérite le respect, à cause de l'honnêteté intellectuelle dont ils font preuve et elle a quelque chose d'émouvant puisqu'ils se débattent contre leur propre logique. Souvent, dans les milieux religieux on traite par le mépris le relativisme, et on estime qu'il s'agit d'une position faible. Ce mépris représente aussi une solution de facilité et il n'est pas toujours (même s'il l'est souvent) justifié. Il y a aussi un relativisme honorable et fort. Nous en avons vu deux exemples.
André Gounelle
Notes :
* Œuvres, 3, p. 84 : par hypostase, il faut entendre ici une réalité éternelle, hors du temps.
* Ibid, p. 85.
* Ibid, p. 83.
* Ibid, p. 85.
* Cf. B.A. Gerrish, "From Dogmatik to Glaubenslehre. A Paradigm Change in modern Theology" in Continuing the Reformation.
* Cité d’après J.M. Aveline L’enjeu christologique en théologie des religions. Le débat Tillich-Troeltsch, p. 95.
* Est absolue, dans la philosophie idéaliste, une réalité qui est totalement conforme à sa définition, pour laquelle il n'y a pas d'écart ni de différence entre son essence et son existence : ainsi une représentation parfaite d'une pièce de théâtre serait qualifiée d'absolue.
* Ibid, p.86-88, 92, 97, 172, 341, etc.
* Ibid. p. 147, p. 91.
* Cf. J.M. Aveline, L’enjeu christologique en théologie des religions. Le débat Tillich-Troeltsch, p. 181.
* Cf. E. Vermeil, "Ernst Troeltsch et le problème des missions chrétiennes à la veille de la Première guerre mondiale", Le monde non chrétien, 1953. B. Reymond, "Troeltsch, Schweitzer et Tillich, ou les voies d'un christianisme désabsolutisé", Laval théologique et philosophique, 1987/1, p. 9.
* E. Troeltsch, "La crise de l'historicisme" in Religion et histoire, p. 206.
* E. Troeltsch, "L'absoluité du christianisme et l'histoire des religions", Œuvres, 3, p. 92.
* Ibid 3, p.120, 143, 150.267.341. "L'édification de la l'histoire de la culture européenne", Religion et histoire, p. 144-147.
* Œuvres 3, p. 148.
* Cité d’après J.M. Aveline L’enjeu christologique en théologie des religions. Le débat Tillich-Troeltsch, p. 185.
* On trouve ce type de raisonnement chez certains théologiens catholiques. Quand un catholique critique tel ou tel aspect ou telle ou telle déclaration de l'Eglise romaine, ils répondent : "si vous en faites partie, vous devez en accepter les lois et les procédés; s'ils ne vous plaisent pas, personne ne vous empêche d'en sortir et de chercher un groupe religieux qui vous convienne mieux". Ce qui exclut toute évolution ou toute réforme. On peut aller jouer à un autre jeu, non tenter de changer les règles du jeu.
![]()
|